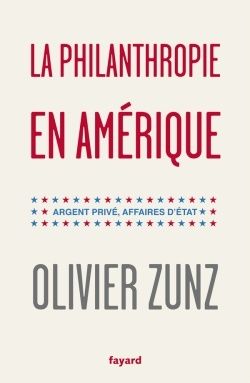 Bill Gates et Warren Buffett iront-ils au paradis ?
Bill Gates et Warren Buffett iront-ils au paradis ?

Renoir Clio Blog
Blog d'histoire-géographie en lycée
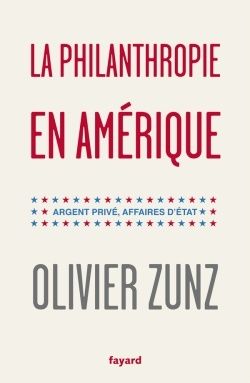 Bill Gates et Warren Buffett iront-ils au paradis ?
Bill Gates et Warren Buffett iront-ils au paradis ?
 Voici les sujets tombés dans les centres de l'étranger:
Voici les sujets tombés dans les centres de l'étranger:

Présentation : De l'Ayiti des Indiens jusqu'à la guerre de libération qui conduisit à l'indépendance d'Haïti, ce
documentaire nous parle des différents combats qu'ont menés des hommes sur cette terre afin de l'en délivrer du joug de la servitude. De Caonabo à Toussaint Louverture, par-delà des luttes de
races ou de couleurs, ces hommes se sont battus pour la Liberté et l'Égalité universelles...
Intervenants : Jacqueline Scott Lemoine (écrivain, comédienne),Odette Roy Fombrun (historienne),Florence Gauthier
(historienne),Ferdinand Abissi (instituteur),Jacques de Cauna (historien),Christianne Taubira (député de la Guyanne),Jean-Louis Donnadieu (historien),Pierre Buteau (historien) Musique :
Micheline Laudun Denis, Adjabel, Raoul Denis jr.
Guerre d'Algérie : pour une histoire à deux voix
LE MONDE TELEVISION | 02.03.12 | 21h26

Cinquante ans après la signature des accords d’Evian mettant fin à la guerre d'Algérie, documentaires et fictions fouillent les mémoires encore à vif pour esquisser une histoire commune aux deux pays, sans tabou ni a priori.D.R.
Surmonter les conflits de mémoires encore à vif pour esquisser enfin une histoire qui rassemble. Une histoire
commune de la France et de l'Algérie, sans tabou ni a priori; une histoire à plusieurs voix mais d'un seul tenant, suffisamment complète pour que tout le monde s'y reconnaisse, assez solide pour
que chacun s'y adosse. Cinquante ans après la signature des accords d'Evian (le 18 mars 1962), ce défi-là reste immense.
C'est à cette tâche que se sont attelés Gabriel Le Bomin et Benjamin Stora. Le premier est réalisateur et
scénariste, familier des images d'archives; le second, né à Constantine en 1950, est historien, spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain et en particulier de la guerre d'Algérie, à
laquelle il a consacré de nombreux ouvrages et documentaires. Le fruit de leur minutieux travail en commun sera diffusé sur France 2, dimanche 11mars à partir de 20h45.
Poignant, parfois oppressant, Guerre d'Algérie, la déchirure constitue le point d'orgue de la programmation des chaînes publiques à l'occasion de l'anniversaire de la signature du cessez-le-feu. Les deux volets de ce documentaire (55 minutes chacun), qui s'articulent classiquement autour de l'année charnière 1958, couvrent l'ensemble de la guerre d'Algérie, de la "Toussaint rouge" de 1954 à l'indépendance en 1962. De nombreux fonds d'archives – notamment ceux de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), de l'armée, mais aussi de télévisions des anciens pays de l'Est – en ont fourni la matière. Le récit se nourrit des mémoires, mais son fil conducteur est bien celui de l'histoire, celle d'une incontrôlable spirale de la violence qui fournit la trame du texte lu par le comédien français Kad Merad (Kaddour Merad de son vrai nom), né en 1964 à Sidi Bel Abbes (Algérie). Toutes les dimensions du conflit sont restituées, parmi lesquelles l'isolement diplomatique de la France, qui pesa sur son issue. Rien n'est passé sous silence. Notamment pas l'extrême cruauté de ces "événements" que l'onmit trente-sept ans à qualifier officiellement de "guerre". En témoignent, parmi d'autres, des images inédites de cadavres de soldats français auxquelles répondent d'autres séquences, comme celle qui montre un "indigène" abattu dans le dos.
L'ensemble est clair, équilibré et compréhensible par le plus grand nombre; en particulier par les jeunes qui
"héritent" encore des soubresauts d'un conflit dont ils pourront, ici, apercevoir la complexité. Si l'on doit ne regarder dans cette période qu'un seul des programmes consacrés à ce
sujet, c'est assurément celui-là.
Si aucun des autres ne se suffit à lui-même, certains valent toutefois le détour. On retiendra notamment
Palestro, Algérie: histoires d'une embuscade. Ce documentaire de Rémi Lainé, coécrit par Raphaëlle Branche, est un bon complément au film de Gabriel LeBomin et de Benjamin Stora. A partir de
l'épisode sanglant dont ont été victimes vingt et un rappelés français en mai1956, les auteurs ont remonté le temps en ce lieu pour chercher à identifier, dans la mise en place du système
colonial, les sources de la violence qui s'y est ensuite exprimée.

Deux documentaires se situent dans un registre plus personnel, signe parmi d'autres que la guerre d'Algérie est une matière encore vivante. Jean-Michel Meurice, qui était jeune officier à l'état-major d'Alger en 1961, évoque ses souvenirs dans son film, Algérie, notre histoire: "On nous disait bien comment tuer, où, quoi, par où, mais jamais pourquoi. Ni qui étaient ces fellaghas qu'il fallait tuer." Auteur d'Une histoire algérienne, le journaliste et réalisateur français Ben Salama, né en 1952 dans un village de Kabylie, ajoute lui aussi sa voix aux témoignages qu'il a recueillis auprès de personnalités françaises et algériennes.
La fiction permet également d'explorer plus avant certains pans de cette histoire. Pour Djamila, réalisé par Caroline Huppert d'après le livre Djamila Boupacha publié en 1962 par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, illustre la bataille qui fut menée par des intellectuels et une partie de la presse française contre l'usage de la torture en Algérie. Tournée en 1965, La Bataille d'Alger, de l'Italien Gillo Pontecorvo, mérite d'être vue (ou revue) pour ce qu'elle est – une reconstitution des épisodes parmi les plus sanglants de la guerre –, mais aussi pour se souvenir de ce que fut ensuite le poids du silence: en l'espèce, quarante ans de censure en France.
La Une du Monde le 2 novembre 1954 lors des premières attaques lançant la Révolution Algérienne.
Article paru dans le supplément, en kiosque avec Le Mondedaté dimanche 4 - lundi 5 mars 2012.
Jean-Baptiste de Montvalon. Article paru dans l'édition du 03.03.12
En mars, à la télévision
France 2
Guerre d'Algérie, la déchirure. Documentaire de Gabriel Le Bomin et Benjamin Stora (2×55 min). Dimanche 11mars à partir de 20h45, suivi d'un débat.
France 3
Pour Djamila. Téléfilm de Caroline Huppert, d'après le livre de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi (103 min). Mardi 20 mars à 20h35, suivi d'un débat.
France 5
Une histoire algérienne. Documentaire de Ben Salama (52 min). Dimanche 18 mars à 22heures.
Arte
La Bataille d'Alger. Film de Gillo Pontecorvo (Italie - Algérie, 1965, 116 min). Lundi 12 mars à 20h35.
Algérie, notre histoire. Documentaire de Jean-Michel Meurice avec Benjamin Stora (90min). Mardi 13 mars à 20h35.
Palestro, Algérie: histoires d'une embuscade. Documentaire de Rémi Lainé (85
min).
Mardi 20 mars à 22h30.
 Après les propos de Claude Guéant
Après les propos de Claude Guéant
« Une mission sacrée de civilisation »
lundi 6 février 2012, par Alain Gresh
« Les forces qui font aboutir le projet grandiose du bonheur parfait ne tiennent nullement compte de la
souffrance d’ordre secondaire, et exterminent ces sections de l’humanité qui leur barrent le passage. (…) Qu’il soit être humain ou brut, l’obstacle doit être éliminé. »
(Herbert Spencer, philosophe anglais, 1850).
Les déclarations de Claude Guéant (« Toutes les civilisations ne se valent pas ») ont déclenché une vive polémique. Elles s’inscrivent, bien sûr, dans la campagne de Nicolas Sarkozy pour gagner les électeurs du Front national. Mais elles vont bien plus loin, car elles reposent la question de ce qu’est une civilisation.
Une remarque préalable. Claude Guéant a noté que la supériorité de notre civilisation tenait, entre autres, à l’égalité entre hommes et femmes. Ce lundi 6 février, le quotidien gratuit 20 Minutes publie une brève, dans la rubrique faits divers, sous le titre « Une femmes assassinée à coups de couteau ». On peut lire : « Samedi soir, une femme aurait été tuée à coups de couteau par son mari à Bruyère-sur-Oise dans le Val d’Oise, selon Le Parisien. La victime est morte sur place, avant que les secours puissent l’accompagner jusqu’à l’hôpital et son mari, soupçonné de meurtre, a été placé en garde à vue. » Ce fait divers, que la presse classera sans doute bientôt dans la rubrique « crimes passionnels », n’est évidemment pas la preuve que notre « civilisation » ne respecte pas l’égalité hommes-femmes. Si c’était un musulman qui en était coupable, en revanche, cela serait la preuve de l’infériorité de « sa » civilisation.
Dans De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Les Liens qui libèrent, 2010), je reviens longuement sur cette idée de civilisation qui est à l’origine de bien des justifications de politiques coloniales au cours de l’Histoire.
Si l’on suit le très documenté Dictionnaire historique de la langue française, publié sous la direction d’Alain Rey, ce n’est qu’en 1721 qu’apparaît le mot civilisation, défini comme « le processus historique de progrès (…) matériel, social et culturel, ainsi que le résultat de ce processus, soit un état social considéré comme avancé ». Civiliser consiste donc « à faire passer [une collectivité humaine] à un état de plus haut développement matériel, intellectuel, social ». Philosophe et orientaliste, auteur du Voyage en Syrie et en Egypte (1787), Volney opposait déjà l’homme civilisé à… l’anthropophage. Le terme de civilisation, qui remplace le mot jusque-là utilisé de mœurs, ne prend donc tout son sens que par opposition à celui de sauvage. Il implique une vision hiérarchique à laquelle il est difficile d’échapper.
Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet (1743-1794), dont l’un des plus grands mérites fut d’avoir défendu avec détermination l’égalité entre hommes et femmes, croit à l’unité de l’espèce humaine et s’oppose farouchement aux entreprises coloniales :
« Parcourez l’histoire de nos établissements en Afrique ou en Asie, vous verrez nos monopoles de commerce, nos trahisons, notre mépris sanguinaire pour les hommes d’une autre couleur ou d’une autre croyance, l’insolence de nos usurpations, l’extravagant prosélytisme ou les intrigues de nos prêtres, détruire ce sentiment de respect et de bienveillance que la supériorité de nos lumières et les avantages de notre commerce avaient d’abord obtenu. »
Le respect des peuples de couleur transparaît dans cette condamnation courageuse et sans équivoque des aventures coloniales. Mais il s’accompagne, chez cet humaniste authentique que fut Condorcet, de la croyance de la « supériorité de nos lumières » – terreau de la formidable effervescence intellectuelle qui préparait la Révolution française. Elle le conduisit à une conviction : la marche en avant des peuples des colonies serait « plus prompte et plus sûre par ce qu’ils recevraient de nous ce que nous avons été obligés de découvrir, et que pour connaître ces vérités simples, ces méthodes certaines auxquelles nous ne sommes parvenus qu’après de longues erreurs, il leur suffirait d’en avoir pu saisir les développements et les preuves dans nos discours et dans nos livres ».
Au nom de cette civilisation dont il est persuadé que l’Europe (et particulièrement la France) représente l’apogée, Condorcet légitime ainsi l’impérieuse obligation de hisser les autres peuples à « notre » niveau. Les restrictions qu’il y met, et notamment l’obligation d’user de moyens pacifiques, d’autres penseurs républicains, d’autres dirigeants politiques de la IIIe ou de la IVe République, les responsables européens en général n’auront aucun scrupule à les violer, camouflant sous cette « mission civilisatrice » des ambitions autrement plus sonnantes et trébuchantes.
A la fin du XVIIIe siècle, en France comme en Grande-Bretagne, se déployait une campagne contre la traite des esclaves et contre les colonies, menée par un courant appelé à un bel avenir, celui des intellectuels libéraux, d’Adam Smith à Edmund Burke. La métropole ne violait-elle pas les principes du marché libre en contraignant ses possessions d’outre-mer à exporter leur production vers la métropole et à y acheter tout ce dont elles avaient besoin ?
Cinquante ans plus tard, la plupart des adeptes de ce courant, de James Mill à John Stuart Mill, en passant par Alexis de Tocqueville, bien que toujours attachés au libre-échange et au rôle central du marché, abandonneront pourtant les questionnements de leurs prédécesseurs pour appuyer, sans états d’âme, l’expansion européenne. Ce « revirement pro-impérialiste » des libéraux, comme le montre l’universitaire américaine Jennifer Pitts, s’explique dans une large mesure par « l’effacement progressif des théories pluralistes et nuancées du progrès au profit de certaines conceptions beaucoup plus méprisantes de l’“arriération” et à une dichotomie beaucoup plus tranchée entre barbarie et civilisation ».
Adam Smith attachait à l’étude des communautés humaines une attention soutenue et il n’aurait certainement pas entériné la formule de Margaret Thatcher selon laquelle « there is no such thing as society » (« Il n’existe pas de société »). Il consacra, au contraire, des ouvrages approfondis non seulement aux sociétés européennes, mais aussi à celles que le Vieux Monde découvrait, de l’Océanie aux Amériques. Il était un universaliste, convaincu que les êtres humains sont tous rationnels et qu’ils appliquent cette rationalité à la résolution de leurs problèmes. Pour lui et ses disciples, aucune culture n’était globalement supérieure ou inférieure aux autres : la diversité des croyances et des mœurs était une réponse à des situations différentes.
Sans jamais céder au relativisme, Adam Smith expliquait ainsi dans sa Théorie des sentiments moraux, publiée il y a cent cinquante ans, que la coutume des Amérindiens de mouler les têtes des nouveau-nés, dénoncée par les missionnaires comme absurde et barbare, n’était pas plus saugrenue que le port du corset imposé aux femmes, dont les effets négatifs étaient connus et néanmoins acceptés… Il condamnait avec force tout ce qui pouvait fonder l’idée d’une supériorité globale des sociétés européennes.
En quelques décennies, le monde va profondément changer. Alors qu’au XVIIIe siècle il était encore multipolaire – en 1800, la majorité de la production manufacturière mondiale se faisait en Chine et en Inde –, durant la première moitié du XIXe siècle l’hégémonie du Vieux Continent s’affirme, et ce pour des raisons diverses : avantages tirés de la conquête de l’Amérique ; profits accumulés du commerce triangulaire (Europe-Afrique-Nouveau Monde) dominé par la traite des esclaves ; et, surtout, maîtrise de la technologie et de l’art de la guerre : la multiplication des conflits en Europe donna aux Etats une capacité à mobiliser leurs ressources pour de longues campagnes militaires, capacité dont ne disposaient pas les immenses empires indien ou chinois, qui déléguaient la défense de leurs lointaines frontières à des potentats locaux ou à des tribus.
Cette capacité militaire et les conquêtes elles-mêmes vont constituer, a posteriori, une preuve de la supériorité non seulement militaire et économique, mais aussi « culturelle » et même « morale » du Vieux Continent, laquelle s’enracinerait dans des conceptions philosophiques que certains font remonter jusqu’à la Grèce antique. On vit ainsi, remarque Jennifer Pitts, apparaître des arguments selon lesquels la nature progressiste de leur civilisation donnait une supériorité morale aux Européens, leur permettant d’agir à leur guise dans les régions « barbares ». La Palestine sera, parmi d’autres, un champ d’application de ces théories.
L’évolution de la politique britannique en Inde en témoigne : au milieu du XIXe siècle, l’intérêt naguère porté à la civilisation de ce pays commence à s’estomper. « Il avait antérieurement existé dans les plus hautes sphères de l’administration, remarque Pitts, une certaine forme d’admiration pour les hauts faits de la culture indienne, y compris parmi les Britanniques œuvrant à l’expansion de l’Empire. Au sein des administrateurs coloniaux du XVIIIe siècle figuraient, en bonne place, des orientalistes admirant la civilisation indienne. »
Ces administrateurs avaient même tendance à s’indianiser : ils s’habillaient comme les locaux, adoptaient leurs coutumes, se mariaient à des Indiennes, etc. A partir des années 1850, au contraire, se fixe une vision méprisante des autochtones, laquelle ne se démentira plus jusqu’à l’indépendance.
Dans un ouvrage stimulant et ardu, au titre provocateur, Provincialiser l’Europe, l’historien indien Dipesh Chakrabarty revient sur la conception qui s’est finalement imposée selon laquelle l’Europe préfigurerait l’avenir de l’humanité. Les peuples non européens, explique Chakrabarty, sont assignés à « une salle d’attente imaginaire de l’Histoire », attente qui devient ainsi une mesure de la distance culturelle qui sépare l’Occident du non-Occident. La notion de progrès, poursuit-il, s’installe dès le XVIIIe siècle, et si « nous » sommes l’avenir, « ils » sont le passé, parfois même notre propre passé : ainsi les Aborigènes d’Australie seront réduits à ressembler à nos ancêtres de la préhistoire qui n’auraient pas su évoluer. En d’autres termes, Karl Marx écrivait que « le pays le plus industrialisé montre aux pays moins développés l’image de leur propre avenir ».
En dépit des puissants mouvements universalistes qui ont marqué l’Europe à partir du XVIIIe siècle, dont les idées étaient en principe peu compatibles avec l’oppression des indigènes, le droit à coloniser s’est donc imposé comme un « droit naturel », voire comme un devoir, de l’Australie à l’Algérie, du Congo à la Cochinchine. En Palestine, il s’agissait aussi d’« une mission sacrée de civilisation » (Henry Laurens). Mais, à la différence d’autres situations coloniales, les Palestiniens ne sont pas assignés à une « salle d’attente » de l’Histoire, mais à en être expulsés définitivement.
 A propos des "lois mémorielles" et du vote du 23 janvier 2012 au Sénat
A propos des "lois mémorielles" et du vote du 23 janvier 2012 au Sénat
Le débat compliqué qui se met en place à propos du génocide subi par les Arméniens et autour des « lois
mémorielles », tendrait-il à faire négliger des réflexions élémentaires en produisant des amalgames ? Il n’est pas acceptable de mêler les lois relatives aux fêtes nationales avec les
préoccupations sur la terminologie à propos de la Shoah, de ne pas différencier les « génocides » des crimes de guerre, ou des violences extrêmes. Pour aller à ce qui est au cœur du débat :
génocide suppose qu’il y ait eu définition de critères désignant un groupe humain à détruire, mise en place de procédures et de moyens. Parce que les souffrances sont toutes respectables, il est
essentiel de ne pas être sidéré devant les pyramides des martyrs qui obsèdent l’univers et de garder le sang-froid nécessaire à la classification et à la hiérarchisation.
Alors sommes nous à ce point démunis qu’il faille que l’Etat légifère nos mémoires ? Les bénéfices de la loi
Gayssot sont-ils aussi assurés qu’il est dit souvent ? Peut-être, mais allons-nous évaluer l’importance des traumatismes collectifs pour définir ce qui sera reconnu ou non comme « génocide » et
qui sera protégé par une loi ad hoc ?
Sans aucune volonté de critique vis-à-vis des élus de la République, il n’est pas souhaitable de leur laisser la
charge de statuer seuls sur ces questions d’histoire. Peut-on lier le respect d’une mémoire à une majorité ? Peut-on faire voter sur la souffrance ? Soyons clair, il n’est pas plus envisageable
de penser que les historiens peuvent mieux trancher. Imaginer que des « historiens sérieux » puissent se prononcer soulève d’emblée la difficulté de savoir qui est « sérieux » et qui ne l’est
pas. Acceptons, faute de pouvoir faire autrement, que les débats contradictoires se mènent, que l’opinion s’empare des propositions et qu’un consensus se crée lentement et sans aucun doute
toujours en étant confronté à des critiques et des contestations. Mais toute affirmation catégorique, appuyée sur un groupe d’experts, même prestigieux, allons jusqu’à penser surtout s’ils sont
prestigieux, risque bien d’être rejetée par l’opinion portée à dénoncer toute procédure d’autorité.
Faut-il rappeler aussi que les approches historiques et les démonstrations des historiens dépendent des climats
culturels dans lesquelles elles s’enracinent ? Il ne s’agit pas d’entamer une discussion sur le « relativisme » de l’histoire, mais simplement de souligner la spécificité d’une méthode recourant
à des concepts et des notions liées à l’actualité dans laquelle elles baignent au moment de leur emploi, d’une recherche dépendant des découvertes jamais achevées de documents et de preuves,
d’une démarche collective qui valide des conclusions qu’au terme de controverses érudites. L’histoire n’est ni une science expérimentale, ni une science « exacte », elles-mêmes soumises aux
influences des opinions collectives par ailleurs, ni le résultat d’un procès disant la vérité en prononçant une sentence. Et c’est précisément pour ne pas céder à une sidération, risquant
d’entraîner vers des positions violentes, passionnées et irrationnelles, qu’il convient de soumettre les « faits » aux grilles interprétatives de l’histoire, avec leurs contraintes et leurs
lenteurs.
Ce sont pour ces raisons que l’histoire ne peut pas être confondue avec la mémoire, quel que soit le sens que
l’on voudrait donner à ce mot. Tous les groupes, nations, communautés, même individus sont partagés entre plusieurs mémoires, complémentaires et rivales, locales et universelles, familiales et
sociales. L’histoire enseignée, l’histoire reconnue par un Etat, n’ont que des rapports biaisés avec ces mémoires qui tissent de façon souple, jusqu’aux affrontements, le tissu identitaire des
personnes et des ensembles humains. Vouloir introduire dans ces négociations continuelles et dans ces rivalités complexes, la rigidité d’une mémoire fossilisée sur une histoire certifiée ne
pourra qu’envenimer des relations, créer des contentieux et interdire les évolutions et les arrangements qui sont la vie même de toute mémoire.
Avons-nous peur à ce point de perdre le contrôle d’un monde à venir dans lequel nos valeurs n’auraient plus de
place ? Si c’est cela la question, demandons-nous pourquoi nous n’avons pas, avant, pu garantir la transmission de ces valeurs, pourquoi la reconnaissance de leur essence ne joue plus. Mais ne
créons pas d’inutiles grandes barrières pour empêcher les barbares de ravager les espaces historiques dont nous voudrions être les seuls gardiens.
http://ihrf.univ-paris1.fr/spip.php?article624
04.05.2011
Il y a 30 ans, François Mitterrand remportait les élections présidentielles contre Valéry Giscard d'Estaing dans un 19 mai 1974 inversé.
Après 23 années passées sous le régime de l’opposition, la gauche se hissait pour la première fois au pouvoir sur l'échelle nationale. Une victoire témoignant d’une puissante volonté de changement chez les électeurs français.
Mitterrand, 50 ans de vie politique(animation)
Liste des sujets du bac général se rapportant à cet événement historique.
 Lettre de Tunisie. La semaine qui a fait tomber Ben Ali
Lettre de Tunisie. La semaine qui a fait tomber Ben Ali
mercredi 19 janvier 2011, par Olivier Piot
Dès le 4 janvier 2010, jour de la mort du jeune Mohamed Bouazizi, qui s’est immolé par le feu le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, « Le Monde diplomatique » a décidé d’envoyer un journaliste en Tunisie. Du jeudi 6 janvier au jeudi 13 janvier, il a sillonné le pays, de Tunis à Tozeur, de Metlaoui à Gafsa, de Sidi Bouzid à Sfax puis Sousse. Son article paraîtra dans notre dossier du numéro de février, consacré aux ressorts de la révolution tunisienne et à l’onde de choc qu’elle a causée dans les pays arabes. En attendant, voici le récit au jour le jour d’une semaine qui est d’ores et déjà entrée dans l’histoire moderne de la Tunisie.
I. La montée de la colère sociale
Jeudi 6 janvier
Tunis, silence des médias
10 h 15, aéroport de Tunis-Carthage. Enregistrement comme « touriste » avec la profession déclarée d’« enseignant ». La police des frontières ne fait aucune difficulté. Destination demandée : « Tozeur, hôtel Ksar El Jerid », au cœur de la grande cité touristique située à 600 kilomètres de Tunis, au sud-est du pays, tout près de la frontière algérienne. La veille, mercredi 5 janvier, le corps de Mohamed Bouazizi, ce jeune bachelier qui s’est immolé par le feu le 17 décembre 2010, a été enterré au nord de la ville de Sidi Bouzid, au centre du pays, à 250 kilomètres au sud de Tunis, en présence d’une foule agitée et révoltée de six mille personnes.
Son nom et les circonstances de sa mort sont ici connus de tous. Giflé en public par un agent de police qui lui a confisqué sa charrette de vendeur ambulant de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi s’est rendu au siège de la municipalité pour porter plainte. On refuse de le recevoir. Personne ne veut l’écouter. Le jeune homme part, puis revient devant le bâtiment pour s’asperger d’essence et s’immoler en place publique. Transferts aux hôpitaux de Gafsa puis de Tunis. Le 28 décembre 2010, une photo de propagande officielle présentant le président Ben Ali à son chevet d’hôpital commence à faire le tour des journaux et des sites Internet. Le président a pris pour la première fois la parole à la télévision, parlant d’« instrumentalisation politique » de l’événement. Le 4 janvier, Bouazizi décède à l’hôpital des suites de ses blessures.
Deux jours plus tard, jeudi 6 janvier, personne ne se doute encore que l’acte désespéré de ce jeune homme de 26 ans va servir de déclencheur à la plus grande révolte populaire de l’histoire moderne de la Tunisie. Pour l’heure, le centre de Tunis est calme et serein, la température douce (20°) et des cohortes de touristes en profitent pour prendre un avant-goût du printemps. Des bus de tour-opérateurs s’apprêtent à les déverser vers La Marsa, Carthage, ou à prendre l’autoroute qui mène à Hammamet, Sousse et Monastir, les grandes cités balnéaires de la côte sahélienne.
Fin de matinée, un kiosque à journaux au coin de la longue et célèbre avenue Bourguiba. Aucun des cinq titres en langue française – Le Temps, La Presse, Le Renouveau, Le Quotidien et Tunis l’Hebdo – ne traite ni de l’histoire de Mohamed Bouazizi, ni des premiers soulèvements qui se sont multipliés entre le 19 et le 24 décembre dans les villes voisines de Sidi Bouzid. Les « Unes » des quatre journaux, comme celles de ceux en langue arabe, sont invariablement consacrées aux mesures d’application du programme de « développement régional » décidé le 15 décembre 2010 par le président Ben Ali.
Hammamet, Monastir, Sousse, Sfax : l’axe autoroutier longe la Méditerranée sur près de 300 kilomètres, à l’est du pays. Quatre heures de voiture pendant lesquelles aucune radio n’évoque jamais le cas Bouazizi. Musique, sport et sujets de société sont au programme de la quinzaine de fréquences qui s’égrènent sur les ondes. Silence des médias officiels, donc. Et ce sera ainsi pendant six jours, jusqu’au mardi 12 janvier. Près de Sousse, une station-service. La cafétéria est animée, remplie de familles tunisiennes et de touristes. Un jeune couple tunisien mange debout des sandwichs. Au seul nom de « Sidi Bouzid », le mari fait signe à sa femme qu’il est temps de partir… Personne n’ose encore parler d’évènements qui ont pourtant débuté depuis déjà plus de deux semaines dans le pays.
Menzel Bouzaiene, « En Algérie, les jeunes osent se révolter pour de bon »
Fin d’après-midi. Un soleil rasant dore les champs et les façades des maisons de la petite ville de Menzel Bouzaiene, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Sfax. Une voie unique de chemin de fer longe cette longue route transversale qui relie Sfax à Gafsa, dans le sud tunisien, juste au nord des chotts El Fedjej et El Jérid. Courte halte au bord de la route, dans une gargote tenue par Mehdi, un Tunisien d’une trentaine d’année. Il ne parle pas français mais maîtrise l’italien. « Un séjour de deux ans à Gênes », explique-t-il, ravi de pouvoir parler cette langue. Pas un seul client dans sa boutique. Le premier qui accepte enfin de parler du suicide de Bouazizi.
Le point de vente d’essence est vide
« Vous êtes ici dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, indique-t-il. La ville de Sidi Bouzid est à 40 kilomètres à peine, au nord. Nous sommes tous concernés par son geste. C’est encore très tendu là-bas. Les familles sont en colère. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés. » En s’approchant, il baisse la voix et devient plus précis : « Dès le 19 décembre, les villes de la région ont réagi, avec de nombreuses arrestations. Le 24 décembre, avant la mort de Mohamed, il y a eu, ici même, des heurts avec la police. Beaucoup de jeunes se sont rassemblés près du commissariat et la police a tiré à balles réelles. Deux morts ! J’ai une dizaine d’amis en prison. » Deux morts, le 24 décembre 2010. Peut-être les toutes premières victimes d’une longue série.
Derrière Mehdi, un poster collé au mur, portrait du président Ben Ali avec le drapeau tunisien. Son frère, plus âgé, entre tout à coup, chargé de viande de mouton. Tous deux s’affairent pour préparer le méchoui du soir. « Impossible d’aller vers Sidi Bouzid, lance le nouvel arrivé. La police a bouclé la ville. C’est dangereux là-bas. Mais ça va se calmer. Au fait, vous avez vu ? ça chauffe en Algérie ! » Mehdi attrape la télécommande et connecte la télévision sur la chaîne Al-Jazira.
Images d’affrontements, jets de pierres, charges violentes de police. A l’écran, Alger a des airs Gaza ! « Là-bas, au moins, les jeunes n’ont pas peur de se révolter pour de bon », lance, amer, le frère de Mehdi. Deux hommes en manteaux de laine sombres viennent de s’installer à une table extérieure. Mehdi change aussitôt de chaîne. Une chanteuse égyptienne lance à présent sa complainte amoureuse. Il a le temps de me faire un signe discret. Deux policiers en civil…
Vendredi 7 janvier
Tozeur, « On risque l’embrasement de tous les quartiers pauvres »
L’hôtel est plein de touristes italiens en vacances scolaires. En ville, les nombreuses échoppes du Bazar sont ouvertes tard le soir. C’est ici, à Tozeur, qu’est née, dans les années 1990, l’appellation de « gazelle » réservée aux jeunes filles étrangères venues profiter des piscines et de la proximité du désert. A la terrasse du Café Le National, cinq hommes, entre 40 et 60 ans, sont attablés autour de « capucins », ces expressos coupés au lait. Animés, Ils parlent en arabe des émeutes. Lorsque je m’approche, la méfiance interrompt leur discussion.
Présentations. Je leur explique qui je suis : « Enseignant français en vacances, syndicaliste en France ». La plupart d’entre eux sont également professeurs et membres de la branche « Enseignement secondaire » de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Rapidement, les langues se délient et les noms de Mohamed Bouazizi et de Sidi Bouzid sont prononcés. « Hier, les avocats ont fait une grève générale à Tunis et dans d’autres villes », précise l’un d’entre eux, enseignant à la retraite. Son voisin enchaîne : « Cette nuit, il y a eu des affrontements violents à Thala et Saïda, au centre du pays. Plusieurs morts… »
Le plus jeune de mes interlocuteurs décide de me faire rencontrer une figure locale, responsable de l’UGTT. Coup de téléphone avec son portable. Vingt minutes après, rencontre avec Hamdi, délégué local et membre du comité exécutif au bureau régional. La soixantaine, les cheveux aussi blancs que ses moustaches, Hamdi me reçoit dans les locaux du syndicat, à deux cents mètres du bâtiment du gouvernorat de Tozeur. Dans un français parfait, il m’explique : « Il n’y a aucune “instrumentalisation politique”, comme l’a déclaré le président le 28 décembre. Sidi Bouzid, Thala, Saïda, c’est simplement un ras-le-bol des jeunes face au chômage qui gangrène ce pays. »
Hamdi s’absente dix minutes. Il veut me montrer un document sur la région de Sidi Bouzid. Sur les murs de son bureau trônent les portraits en noir et blanc des dirigeants historiques de l’UGTT, depuis sa création en 1947. A son retour, le cadre syndical me présente un mince rapport réalisé par le syndicat, rédigé en arabe et intitulé « Développement économique à Sidi Bouzid : entre mythe et réalité - août 2010 ». Nous le parcourons ensemble. Hamdi traduit. « Près de 50 % de chômage chez les jeunes diplômés à Sidi Bouzid, indique-t-il. Et c’est comme ça dans tout le centre, l’ouest et le sud du pays. En fait, les seules régions épargnées sont les zones touristiques : Tozeur et la côte sahélienne. (…) Taux de scolarisation jusqu’au bac : 95 % ! C’est bien, mais avec quels débouchés ? »
En reposant le document, Hamdi tire nerveusement sur sa cigarette. « Les avocats c’est bien, mais ça ne suffira pas. Pareil pour les manifestations d’artistes et de professeurs qui ont eu lieu ça et là aujourd’hui. C’est toutes les écoles qui doivent bouger. Avec le syndicat, nous appelons à une grande grève des enseignants du primaire et du secondaire les 26 et 27 janvier. » Silence. A plusieurs reprises, il répond au téléphone. « Les 26 et 27 janvier ? Dans trois semaines ? » Ma question le laisse songeur. Hamdi me fixe : « C’est long, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit pas trop tard. Je l’ai dit aux dirigeants du syndicat, mais ils sont très liés au pouvoir. Moi, j’ai le sentiment que d’ici là, on risque l’embrasement de tous les quartiers pauvres des villes du centre et du sud. »
Samedi 8 janvier
Tozeur, l’info en temps réel sur France 24 et Al-Jazira
Je dois lui faire confiance. Seul depuis deux jours, je dois trouver un guide et traducteur. Né à Kairouan, Wael, 45 ans, est parfaitement francophone. Rencontré dans un café de Tozeur alors qu’il regardait Al-Jazira, il a accepté d’être traducteur en restant avec moi pendant plusieurs jours. Il sait que notre parcours passera par des villes sous tension, mais il en accepte le risque. Depuis plus de quinze ans déjà, ce maçon de profession complète ses revenus comme chauffeur de 4x4 pour des circuits touristiques dans la région de Tozeur. « Du boulot à la journée, de temps à autre, surtout en été, avec en général des missions de 5 heures du matin à minuit, payées 20 dinars tunisiens par jour [10 euros, ndlr] et sans jamais savoir à l’avance si on aura besoin de moi », précise-t-il. Marié depuis deux ans, sans enfants, Wael fait vivre avec son salaire sa femme (sans travail), ses deux jeunes frères (au chômage) et sa mère de 72 ans, veuve depuis dix ans.
En arrivant tôt ce matin, Wael m’apprend qu’il a suivi une bonne partie de la nuit l’actualité en arabe sur Al-Jazira et France 24, les deux chaînes en langue arabe les plus regardées en Tunisie. « Elles traitent des tensions depuis le 19 décembre, m’indique-t-il, mais leurs reportages et débats sont maintenant très soutenus. J’ai appris que le journal français Le Monde était censuré dans le pays et que leur journaliste n’a pas été autorisée à venir en Tunisie. De violents affrontements ont eu lieu cette nuit à Kasserine. Ils parlent de cinq morts dont deux jeunes. » Puis, en prenant le volant, Wael tient à préciser : « Il faut faire attention. On peut passer à Redeyef, mais il faut surtout ne pas remonter vers Kasserine et Thala : la répression devient sévère là-bas. On ira sur Gafsa. C’est plus sûr. »
Redeyef, « Ne prononce jamais en public le nom de Ben Ali ! »
Redeyef, 11 heures. La ville minière du grand bassin de phosphate géré par la Compagnie générale du phosphate (CGP), au cœur du grand gouvernorat de Gafsa, vit des heures apparemment tranquilles. Un train miniature, locomotive et wagons de transport du minerai, trône telle une statue au milieu du carrefour, près du bazar. « Tout le monde ici, ou presque, travaille à la mine ou dans les entreprises de sous-traitance », m’informe Wael. En 2008, la grande grève du « peuple des mines » de Redeyef (voir « Révolte du “peuple des mines” », par Karine Gantin et Omeyya Seddik, Le Monde diplomatique, juillet 2008) a fait connaître la ville (40 000 habitants) bien au-delà des frontières tunisiennes.
Un petit restaurant de méchoui près du centre ville. La salle est vide. Au-dessus de la caisse, cet éternel portrait où plastronne Ben Ali, costume sombre, les cheveux plaqués, avec à ses côtés un énorme drapeau tunisien. Deux hommes viennent à leur tour déjeuner. Ils s‘installent juste à côté de nous. Wael me fait signe qu’on peut discuter : le code a été mis au point une heure plus tôt, dans la voiture.
Notre premier voisin, Meher, la cinquantaine, travaille dans une entreprise de logistique sous-traitante de la CGP ; le second, Ala, proche de la retraite, à la mine depuis trente ans. Discussion sur le chômage et les salaires. « En 2008, déjà, la grève avait débuté ici sur la question du recrutement des jeunes à la mine », précise Ala. « Les salaires de la CGP sont plutôt bons, poursuit Meher, mais le nombre de personnes à vivre dessus augmente sans cesse. »
Progressivement, les échanges dérivent vers la situation dans le pays. Sidi Bouzid, Kasserine, Thala : qui sont les émeutiers ? « Des jeunes en galère, rien de plus », lance Meher. « Les villes les plus pauvres du pays, celles que le régime a délaissé depuis vingt ans », surenchérit Ala. Dans le feu des propos de plus en plus libres, je montre du doigt le portrait du président tunisien en disant : « Ben Ali, il va pas être content ! »
Silence subit, lourd. Ala et Maher n’ont pas fini leur repas, mais ils se lèvent, ramassent leurs affaires et quittent le restaurant sans un mot . « Il ne faut pas parler comme ça, s’énerve aussitôt Wael, mon traducteur. Tu peux parler de questions sociales, doucement, mais ne prononce jamais en public le nom de Ben Ali. Jamais plus ! »
Metlaoui, « L’immolation est devenue le symbole de notre révolte »
15 heures. En entrant dans Metlaoui (50 000 habitants), après avoir dépassé l’autre ville minière Moulares, la route est bordée d’immenses structures aériennes fermées, destinées au transport sur tapis du phosphate. Un bus nous barre la route. L’arrêt se prolonge. Un brouhaha monte. Des gens commencent à s’attrouper. A cent mètres de notre voiture, une dizaine de jeunes viennent de sortir dans la rue avec un brancard métallique qu’il portent et sur lequel gît le corps d’un homme drapé d’une couverture rouge et blanche. « C’est le jeune qui s’est immolé il y a deux jours, me prévient Wael. Ils vont l’enterrer. » Silencieuse, la manifestation ne rassemble encore qu’une vingtaine de jeunes. Premières photos.
Funérailles de Mosbah Al Jawhari, qui s’est immolé le 6 janvier
Nous reprenons la voiture pour contourner par les petites ruelles, à l’écart du souk où le cortège se dirige. Je laisse Wael avec le véhicule au sud de la ville pour remonter vers le centre à travers le souk. De toute part, les marchands rangent vite leurs étals. Beaucoup s’éloignent vers les quartiers sud. Remontant ce flux dense d’hommes, de femmes et d’enfants mêlés, un groupe se dirige vers la grande artère du centre ville. La rue s’est vidée. Sur la gauche, le front d’un cortège avance. Il compte à présent près de quatre à cinq cents personnes, surtout des jeunes.
Pas de slogan, aucune pancarte. Quelques cris de femmes, à l’écart, sporadiques. Les visages sont tendus, sévères. J’aperçois à présent nettement le corps du défunt. Mon voisin se penche vers moi : « C’est la troisième personne qui s’immole. Il y en a eu un autre à Sidi Bouzid, aujourd’hui même, un père de famille de 50 ans. L’immolation est devenue le symbole de la révolte. » Nouvelles photos. Une, deux, trois… Juste avant qu’une main ferme ne me saisisse à l’épaule. « Donne-moi ta caméra », me lance nerveusement un jeune homme, la trentaine, vêtu d’une veste de cuir noir. Refus. J’exige de voir sa plaque de police. L’homme est rejoint rapidement par quatre autres qui tentent de m’empêcher de mettre mon appareil dans ma poche. Echec.
Plusieurs coups de téléphone sur les portables. Le cortège est passé devant nous. Il se dirige vers le lieu d’inhumation. « Un officier de police va venir, suis-nous », commande le policier en civil. Un peu plus loin, le groupe me fait entrer dans une boutique de photo. « Donne ton appareil, il nous faut les photos. Tu n’as pas le droit en Tunisie de photographier des bâtiments officiels. » J’exige d’attendre l’officier avec son badge. La main dans la poche, j’ai eu le temps en marchant d’extirper discrètement ma carte mémoire que j’ai cachée dans ma chaussette en renouant mon lacet.
L’ officier arrive, présente sa carte et tend mon appareil au gérant du magasin – vide. « Où est la carte ? » lance l’officier avec rage. « J’ai oublié de la mettre ce matin. » La réponse le rend nerveux. Il hésite, passe plusieurs coups de téléphone. Personne n’ose me fouiller. Ils finissent par me laisser partir, avec mon appareil, après avoir exigé mon passeport et noté mon identité.
Wael m’attend toujours au sud du souk. Nous filons sur Gafsa. Dans la voiture, il n’est pas content du tout. « C’est trop risqué, j’arrête », lâche-t-il. Pour la première fois, je le sens apeuré, comme s’il mesurait lui-même ce qui est en train de se passer dans son pays. Nous convenons qu’une fois à Gafsa, il prendra un bus pour rentrer chez lui.
II. L’indignation devant la répression policière
Dimanche 9 janvier
Gafsa, « Il faut que l’UGTT lance des mots d’ordre ! »
8 heures du matin, devant le siège de l’union régionale de l’UGTT. Depuis la sortie de mon hôtel, je suis suivi en permanence par un jeune en scooter, écharpe noire sur le visage, casquette sur la tête. Il ne me lâchera pas d’une semelle jusqu’à mon départ pour Sidi Bouzid. Avec une agglomération de plus de 150 000 habitants, Gafsa est l’une des plus grandes villes du pays. Une quinzaine de personnes discutent dans la petite cour du bâtiment syndical. Le cas de l’immolé de Metloui et du second de la ville de Sidi Bouzid sont confirmés.
« C’est surtout dans les quartiers de Kasserine que ça chauffe à présent, lance un délégué local de l’UGTT. Ils ont même envoyé l’armée. C’est la première fois depuis le 17 décembre. » A ses côtés, une femme prend la parole. La trentaine, elle est militante au Parti démocratique progressiste (PDP), une formation d’opposition légalisée depuis 1988 mais qui a boycotté les dernières élections et demeure sans représentant à la Chambre des députés. « Y en marre que l’UGTT ne bouge pas ! C’est une trahison. Les Tunisiens s’en souviendront », lance-t-elle, virulente.
La discussion s’anime. « La direction nationale de l’UGTT est corrompue depuis des années, rétorque Skader, 26 ans, un autre militant du PDP. Il faut que localement nous les débordions en les forçant à organiser des rassemblements et à décréter la grève générale. » Jusqu’ici, la direction nationale du syndicat n’a pris aucune position officielle sur les événements de Tunisie. Ici, à Gafsa, le scénario d’un « débordement » par la base est presque impossible, tant le dirigeant régional du syndicat a fait preuve d’allégeance au pouvoir central. « Si nous réussissons à mobiliser les mineurs, c’est tout le bassin qui peut basculer et faire tomber Ben Ali », assure Skader.
Dans ce cercle de militants associatifs, politiques et syndicaux, le ton est devenu clairement politique. La révolte sociale est en passe de se transformer en contestation politique du régime. « Derrière la question du chômage doit monter la dénonciation d’un régime liberticide, qui fonctionne comme une mafia depuis plus de vingt ans », assène Skader.
Sidi Bouzid, « Mohamed n’est pas mort pour rien ! »
Je quitte Gafsa en m’arrêtant à plusieurs reprises pour demander la direction de Sfax. Le jeune qui me suit a sûrement entendu. Puis, profitant d’une large avenue sans trafic, j’accélère, le laissant loin derrière moi. Au premier rond-point, je bifurque vers Kairouan, direction Sidi Bouzid.
Midi. La petite ville de Bir El Hfey (15 000 habitants), à 60 kilomètres au nord de Gafsa, est toute à ses activités commerciales. Riche en fruits et légumes, réputée pour sa viande de mouton, cette commune située au cœur du gouvernorat de Sidi Bouzid profite de terres fertiles irriguées par l’oued El Chaca, l’un des plus grand du pays. « Vous pouvez passer à Sidi Bouzid, assure un restaurateur. La police est partout mais la ville est calme à présent. »
Vingt-cinq kilomètres plus au nord-est, le panneau « Sidi Bouzid » apparaît le long d’une route bordée de maisons basses, sans étage, la plupart inachevées. Une commune en chantier, marquée par le chômage et la répression policière, avant même les heurts de décembre 2010. Près de la grande mosquée, des dizaines de policiers casqués et armés, membres des Brigades d’intervention de gendarmerie (BIG) et des Brigades de l’ordre public (BOP), sont stationnés près du commissariat.
A l’écart, le quartier populaire d’Ennour Gharbi a tout d’un bidonville. Façades délabrées, poubelles dans les rues, enfants qui courent entre les sacs plastiques. C’est le quartier où vivait Mohamed Bouazizi. Ses trois sœurs, sa mère, son oncle et deux de ses trois frères y habitent une maison modeste. Après des discussions discrètes, çà et là, en surveillant sans cesse ces visages qui pourraient être ceux de policiers en civil, Zied, un garçon de 25 ans, décide de m’aider. En empruntant de longs détours dans le quartier, il me guide jusqu’à la maison.
Une pièce unique, coussins au sol. Leïla, la plus grande des sœurs de Mohamed, me tire par la manche. « Mohamed n’est pas mort pour rien, lâche-t-elle, les yeux mouillés. Regardez ce qui se passe dans le pays. C’est du jamais vu ! » Pendant trois quarts d’heure, les sœurs et la mère de Mohamed me racontent son histoire, leur histoire. Puis, avec l’oncle, installé ici depuis la mort du père de famille, voilà quinze ans, nous allons en voiture sur la tombe du défunt, située à 20 kilomètres au nord de Sidi Bouzid.
La famille de Mohamed Bouazizi à son domicile
Samia, 15 ans, Basma, 19 ans, Leïla, 24 ans, et Manoubia, leur mère, 55 ans, installées devant un ordinateur prêté par un voisin. Sur l’écran, la photo de Mohamed lors d’un mariage, sur Facebook.
Bir El Hfey, « On est chez nous ici, on fait ce qu’on veut ! »
17 heures, retour à Gafsa par Bir El Hfey. La leçon de Métlaoui est encore gravée dans ma tête. La carte mémoire de mon appareil photo est déjà à l’abri. A la sortie de Bir El Hfey, deux voitures me barrent la route. Huit hommes en descendent. « Votre caméra s’il vous plaît. » J’exige des insignes officiels de police. Le chef du groupe, un homme d’une soixantaine d’année, saisit son portable et discute longuement en arabe. Nous restons sur le bord de la route une demi-heure.
« Suivez-nous au poste », lance tout à coup celui qui semble le chef. Il monte dans ma voiture et me demande de me garer juste devant le commissariat de la ville, en bord de route. Une dizaine de policiers en civil nous attendent, postés devant le bâtiment. « Voilà, vous avez des policiers devant vous. La caméra s’il vous plaît. » J’exige toujours une procédure officielle pour donner mon appareil photo. Les policiers en civil refusent que j’entre dans le commissariat. Nouveaux coups de téléphone. Le chef a pris mon passeport et attend des nouvelles. Un ordre, sans doute. Le lien avec Metlaoui est forcément fait.
Une heure encore devant le poste. Attente interminable. Vers 18 h 30, alors que la nuit est tombée depuis un bon moment déjà sur Bir El Hfey, quatre de mes gardes en civil se jettent subitement sur moi et cherchent à arracher de force mon appareil rangé dans ma poche. J’agrippe ma veste de la main droite pour protéger mon matériel : « Qu’est-ce que vous faites ? J’ai demandé une procédure normale avec un officier de police ! »
En me serrant le cou de son bras droit, le chef du groupe, cette fois, aboie : « On est chez nous ici, on fait ce qu’on veut. » Dix minutes à me défendre jusqu’à ce qu’un des hommes sorte un bout de bois et m’assène un coup violent sur la main droite. Sous la douleur, je lâche le tissu de ma poche et les hommes s’enfuient avec mon appareil photo. La carte est restée dans le col de ma veste. Joint au téléphone, le consulat de France me conseille de me mettre à l’abri. Je fonce vers ma voiture et démarre en trombe, direction Gafsa.
Dans mon rétroviseur, quatre phares ne tardent pas à percer dans la nuit. Ils sont à environ un kilomètre derrière moi. Avec ma petite Chevrolet louée à l’aéroport de Tunis, je n’ai plus le choix : 180 kilomètres-heure sur cette route désertique, en pleine nuit, avec une seule main valide pour tenir le volant. La peur au ventre. La certitude qu’ils vont me rattraper là, en plein désert, seul. Et qu’ils pourront faire ce qu’ils veulent… Trente minutes qui durent une éternité. Une demi-heure d’angoisse avant d’atteindre les premières lumières de Gafsa. C’est fini : trop de témoins. Leurs phares disparaissent derrière moi. Direction l’hôpital de Gafsa.
Lundi 10 janvier
Gafsa, « Des snipers tirent dans la tête des jeunes leaders »
Nuit à Gafsa, sous la protection de syndicalistes de l’UGTT qui m’ont accueilli dès l’hôpital, la veille au soir. Neuf heures du matin, devant le siège du syndicat. Le jeune en scooter a repris du service. Cette fois, les événements de Tunisie sont discutés partout. Dans les cafés, sur Al-Jazira et France 24, jusque devant les écoles où professeurs et élèves se rassemblent régulièrement. Mais toujours rien dans la presse et sur les radios officielles. A la suite de l’agression de Bir El Hfey, Karim, la soixantaine, membre d’Amnesty International et sympathisant du mouvement d’opposition légal Ettajdid (« Pour la rénovation »), représenté par deux députés à la Chambre, propose de m’accompagner jusqu’à Tunis.
« Le président va parler à la télévision dans l’après-midi, pour la seconde fois depuis décembre 2010 », m’indique-t-il (la première intervention de Ben Ali a eu lieu le 28 décembre). Les autorités font état de quatorze morts depuis le 17 décembre. Mais les associations humanitaires et les partis d’opposition parlent de plus de trente. La veille, près de Sidi Bouzid, dans la commune de Regeb, des affrontements ont eu lieu : deux morts et des dizaines de blessés. Et toujours, des arrestations massives.
Dans la petite cour du syndicat, les discussions entre militants se poursuivent. Ils sont cette fois une centaine, révoltés par les nouvelles de la nuit. « Des photos et des vidéos ont circulé sur Facebook, m’explique Skader, le militant du PDP rencontré la veille. Postés sur le toit des immeubles, des snipers tirent dans la tête des jeunes leaders des émeutes ». Comme une traînée de poudre, cette nouvelle fait le tour de la Tunisie, transmise par Facebook, les portables, portée par des milliers de courriers électroniques.
Meknassy, « Personne ne croit plus aux promesses du président ! »
16 heures. A mi-chemin entre Gafsa et Sfax, nous nous arrêtons avec Karim dans la petite ville de Meknassy. La radio vient d’annoncer la retransmission du discours de Ben Ali. Depuis le 6 janvier, c’est la toute première fois que j’entends les radios officielles traiter des événements. Nous nous installons dans un café, devant l’écran de télévision. Autour de nous, une vingtaine de jeunes et de personnes plus âgées fixent l’écran. Les visages sont tendus. Un silence de plomb plane sur la ville.
Le visage du président est sévère, le ton assuré, les propos en arabe littéraire. « Actes de terrorisme », « éléments étrangers », les premiers mots de Ben Ali font réagir l’assistance. Des policiers en civil sont dans la salle. Chacun se retient, fait attention, écoute à nouveau Ben Ali. Puis le président promet la création de « 300 000 emplois en deux ans », des « réunions de concertation » avec toutes les autorités locales, une « commission d’enquête »… La séquence a duré moins de dix minutes. « Allons-y », me lance aussitôt Karim. Les policiers en civil viennent de lancer des arrestations dans le café.
Dans la voiture, Karim décrypte l’intervention présidentielle. « Il lâche un peu, mais personne en Tunisie ne croit plus aux promesses du président. L’emploi, la concertation : ce sont des choses qu’il dit depuis vingt ans sans jamais s’être donné les moyens de le faire. Dès ce soir et demain, c’est sûr, les rassemblements vont se poursuivre. »
Sousse, « C’est honteux de laisser des jeunes en galère se faire massacrer »
20 heures, nous sommes dans un restaurant de Sousse, l’une des grandes villes touristiques du Sahel tunisien (650 000 habitants). Karim a eu des amis au téléphone. « C’est parti à Gafsa, annonce-t-il. Dans les quartiers populaires d’El Ksar. Deux morts, des banques saccagées, des arrestations. » Le même scénario se reproduit et s’élargit. « A Kairouan aussi et même à Gabes et Douz », poursuit Karim. Des villes restées jusqu’ici à l’écart de la colère sociale.
Nesrine, la fille d’un ami de Karim, nous a rejoints avec une amie, Nadia. Elles ont toutes les deux 24 ans et sont venues de Gafsa poursuivre leurs études supérieures à Sousse. Soignées, habillées à l’occidentale, les deux étudiantes – l’une en médecine, l’autre en informatique – ont conscience de faire partie de cette classe moyenne qui s’est développée dans le pays depuis 1990. « Je crois que Ben Ali est mal conseillé, commence Nesrine. C’est un bon président, mais il s’est laissé influencer par sa seconde femme, Leïla. C’est elle et le clan des Trabelsi qui dirigent et pillent les richesses du pays. »
A ses côtés, Nadia est plus discrète. Elle écoute son amie. Opine de temps à autre. Mais, sur les snipers et la répression des jeunes depuis trois semaines, elle est intraitable : « Le chômage touche surtout les quartiers populaires, lance-t-elle, la voix ferme. Ici à Sousse, les gens ont du travail. Mais si la police continue à utiliser ces snipers et à tuer systématiquement les jeunes, nous allons bouger nous aussi. Nous sommes en démocratie ou quoi ! C’est honteux de laisser des jeunes en galère se faire massacrer tous les jours sous nos yeux. »
III. Place au mouvement politique
Mardi 11 janvier
Tunis, « Cette fois, ça va bouger à Tunis ! »
La capitale, 11 heures du matin. En dehors de quelques manifestations d’avocats, de professeurs et d’intellectuels, Tunis est restée calme depuis le début des évènements. Karim me propose d’aller dans les locaux du mouvement Ettjdid, en plein centre ville. La veille au soir, craignant que le mouvement ne s’étende aux écoles et universités, le gouvernement a annoncé la fermeture complète de tous les établissements scolaires du pays.
Dans la journée, plusieurs journalistes français et espagnols se présentent dans les locaux. Notamment la correspondante de RFI au Maroc, arrivée le matin même, officiellement autorisée à travailler à Tunis comme « journaliste ». J’apprends que la veille, le correspondant du Figaro était à Tunis. L’étau se desserre. Enfin, le régime a compris qu’il avait perdu la bataille de la communication. Certes, les sites de partage de vidéos YouTube et Dailymotion restent censurés, comme la plupart des sites que je consulte (« Erreur 404 »…), mais Ben Ali a visiblement décidé de lâcher un peu de lest devant les informations qui, de toute façon, passent par Internet depuis quinze jours.
Cette fois, les journaux officiels reviennent en « Une » sur le discours de la veille du président. Articles très officiels, sentencieux, sans commentaires. Parole donnée aux officiels du régime. Idem sur certaines radios. Il n’empêche, « ça va bouger à l’UGTT », m’annonce Salmi, un cadre du mouvement Ettjdid. La direction nationale a pour la première fois pris position en déclarant « légitime » le mouvement de jeunes. Et ils ont condamné la répression policière. Plusieurs militants et personnalités de l’opposition passent dans les bureaux d’Ettjdid. Un correspondant espagnol y a même élu domicile depuis une semaine.
Vers 17 heures, Nadhir, 24 ans, un jeune étudiant de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET), le grand syndicat étudiant fondé en 1953 et interdit depuis de longues années, s’insurge contre la fermeture des universités. « Ils ont peur qu’on rejoigne le mouvement, précise-t-il. Et c’est vrai que sans les locaux des écoles et des universités, c’est très dur de rassembler les étudiants et de tenir des AG. » Mais Nadhir ne perd pas espoir : « Les quartiers populaires de Tunis [des cités dortoirs de près de 500 000 personnes, ndlr] ne sont pas fermés. J’ai eu des informations. Cette fois, ça va bouger à Tunis. » Le soir même, sous la pression, les dirigeants de l’UGTT annoncent qu’ils autorisent certaines directions régionales, dont celle de Sfax, à organiser localement la « grève générale » dès le mercredi 12 janvier. Le vendredi 14 janvier, ce sera au tour de Tunis.
Mercredi 12 janvier
Sfax, « Vendredi, on sera tous à Tunis »
Cap sur Sfax, 11 heures. Yasmina, 27 ans, est arrivée tôt de la ville côtière et touristique de Sousse. Deux heures de voiture, par l’autoroute, pour rallier Sfax, la grande ville portuaire du sud (avec Gabès) située à trois cents kilomètres au sud de Tunis. Avec près de 500 000 habitants, l’agglomération est la deuxième de Tunisie et son plus grand port, juste après Bizerte. « Il était temps que le syndicat déverrouille enfin la situation et entre dans l’action », indique Yasmina.
Autour d’elle, sur une petite place du centre ville, loin des docks, des centaines de jeunes, de professeurs, de salariés se sont rassemblés. Les journaux circulent. Chacun donne des nouvelles. « C’est parti à Tunis cette nuit », lance un manifestant. « Oui, ils ont même déployé l’armée dans la capitale », ajoute aussitôt son voisin. « Du jamais vu depuis le coup d’Etat de Ben Ali, en 1987 ! » Partout les rideaux des commerces sont baissés, les cafés fermés, les kiosques aveugles. « C’est un succès, près de 90 % des Sfaxiens ont répondu à notre appel », se félicite Mohamed, la cinquantaine, militant à l’UGTT locale des cheminots.
La situation économique et sociale à Sfax est pourtant très différente de celle des villes du centre et de l’ouest du pays. Ici, pas d’énormes quartiers populaires frappés par la misère et le chômage. Cité prospère et port florissant, Sfax est depuis près de deux siècles une ville commerçante dont le dynamisme a été porté par les oliveraies, le chemin de fer et le transport maritime du phosphate. « C’est une ville de bourgeoisie et de classe moyenne, explique Mohamed. Mais là les gens en ont marre. Les violences du régime contre les jeunes de Kasserine ou Sidi Bouzid ont fini par les exaspérer eux aussi. »
Soudain, près du syndicaliste, deux jeunes lycéens s’affolent. « Ils tirent dans le quartier sud ! », lâche l’un d’entre eux. Les téléphones portables fonctionnent à plein régime. « A Douz, deux morts ! » Tendue, Yasmina écoute. Elle saisit elle aussi son portable. Chacun est sur écoute. Tout le monde s’en moque : « Ils ont autre chose à faire que de nous écouter », lance Yasmina en raccrochant. « C’était une amie, dans un autre quartier de Sfax. Elle confirme, ils viennent de tuer un jeune. »
Yasmina fait partie de cette classe moyenne qui a profité jusqu’ici de la bonne santé économique du pays. « C’est la première fois que je manifeste, confie-t-elle. Là, le régime va trop loin. Ce ne sont plus seulement les jeunes au chômage qui vont bouger, mais tous les Tunisiens qui vont descendre dans la rue. Vendredi, on sera tous à Tunis. »
Retour dans la capitale. Cet après-midi, Ben Ali a annoncé le limogeage du ministre de l’intérieur, Rafik Belhaj Kacem. C’est le deuxième remaniement depuis décembre. D’autres vont suivre. Selon les autorités, le nombre officiel de morts est passé à vingt-et-un dans tout le pays. Mais le siège à Tunis de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) parle « d’au moins trente-cinq morts et des milliers de blessés et d’arrestations ». Le couvre-feu est décrété à Tunis et dans sa banlieue.
Jeudi 13 janvier
Tunis, « Aucun Tunisien ne pardonnera plus à Ben Ali »
Très tôt dans la matinée. Après une première nuit de couvre-feu, les véhicules de l’armée sillonnent toujours les grands axes de la capitale tunisienne. Devant le ministère de l’intérieur, une trentaine de policiers en tenue montent la garde avenue Bourguiba. Les terrasses de café commencent à se remplir. « Quel bordel ! » Au volant de son taxi, Mourad, 48 ans, tempête dans un français approximatif. Au premier feu rouge, il se penche et extirpe de sous son siège un morceau de bois grand comme une batte de base-ball. « Voilà avec quoi il faut travailler maintenant ! », lance-t-il, excédé. Peur des émeutes ? Des jeunes en colère ? « Non. Pas du tout ! C’est pour les policiers. Ce sont eux les voyous en Tunisie. »
Né à Kairouan, au centre du pays, ce fils de commerçant n’a pas fait d’études. Après avoir tenté sa chance dans des hôtels et commerces du Sahel (la côte tunisienne), il est venu à Tunis en 1992 grâce à son père et ses frères qui l’ont aidé à acheter sa licence de taxi. Et puis « trente ans d’emprunt, explique-t-il. De toute façon, tout le monde est surendetté dans ce pays ». A la radio, une journaliste rappelle les principaux événements de la veille : « Démission du ministre de l’intérieur », « ouverture d’une commission d’enquête sur la corruption », « grève générale à Sfax, de nombreux blessés et deux morts », « cinq morts à Douz »… Mourad écoute avec attention.
« Il disent rien des nouveaux affrontements cette nuit à Ettadhamen. Moi j’y habite, je sais de quoi je parle. » Ettadhamen, l’une des cités-dortoirs de Tunis. Un quartier populaire, gonflé des vagues successives de cet exode rural qui pousse vers la capitale des milliers de Tunisiens depuis des décennies. Avec les cités voisines, près de 450 000 habitants délaissés par les performances officielles de l’économie tunisienne. « On a à nouveau été réveillés cette nuit par les tirs de la police. Ce matin, j’ai vu de nouvelles carcasses de bus et de voitures. Et rien dans les journaux ! »
Mourad décide subitement de faire un détour pour montrer sa cité. Le trafic n’est pas encore saturé dans la capitale. Trop tôt. En une demi-heure, nous atteignons les rues d’Ettadhamen qu’il souhaite montrer. « Regardez là-bas », lance-t-il en désignant une carcasse de bus calcinée. Autour, des façades de maisons et de commerces encore noircies par les heurts de la nuit. « C’est la seconde nuit d’émeutes ici. La prochaine, c’est toutes les cités qui s’embrasent », commente Mourad. Autour du taxi, des jeunes passent en courant. A cent mètre, la police a dressé un barrage. « Mieux vaut partir. »
Demi-tour vers le centre-ville. Silencieux, le chauffeur surveille la route. Il a éteint nerveusement la radio et peste contre un homme qui passe juste devant son véhicule. Puis il reprend le fil de ses pensées. « Demain c’est la grève générale à Tunis. Tout le monde sera dans la rue. En tout cas, moi, j’y serai. Et je ne connais personne qui n’y sera pas. » Est-ce la fin du régime de Ben Ali ? Mourad n’hésite pas une seconde. « C’est fini, lâche-t-il, sombre. C’est fini cette fois. Fallait faire les choses plus tôt. C’est trop tard. Il ne fallait pas qu’il laisse le clan des Trabelsi [la famille de la seconde épouse du président Ben Ali, ndlr] piller le pays comme ils l’ont fait. Des banques, hôtels, sociétés de télécommunications, agences d’automobiles… Ils ont tout pris. C’est trop tard. Aucun Tunisien ne lui pardonnera plus. »
Tunis, Les snipers de Tunis-Carthage
Depuis plusieurs jours, les médias et Internet parlent de ces snipers aperçus à Thala, Kasserine et Douz. Des images ont circulé sur Facebook, floues, imprécises. Postés sur les terrasses des immeubles, ces tireurs seraient à l’origine de nombreuses morts parmi les jeunes manifestants. La nouvelle a largement contribué à la révolte des Tunisiens face à la répression policière qui sévit dans le pays depuis plusieurs jours.
Des rumeurs ? 9 h 40, jeudi 13 janvier, devant l’entrée de l’aéroport de Tunis-Carthage. Depuis la fin du couvre-feu, les taxis déposent ici les flots de touristes et d’hommes d’affaires qui souhaitent quitter le pays. Trois 4×4 gris métallisé, vitres teintées, viennent tout juste de se ranger devant la porte principale. Brusquement, au pas de course, une dizaine de militaires en tenue de camouflage, veste jaune fluo, sortent de l’aéroport. Equipés de longues mallettes noires et de petites valises grises, ils s’engouffrent dans les 4×4 qui partent en trombe. Maîtrisée, la scène a duré moins d’une minute.
A l’intérieur, les visages anxieux des voyageurs sont tournés vers le panneau d’affichage. Le vol Air France de 9 heures a été annulé, ceux de Tunis Air sont incertains. Au bar du niveau des arrivées, Pierre H. attend des « collègues » qui doivent venir le chercher. Il débarque de Paris et vient pour affaires. Cet ancien officier de l’armée française, la soixantaine, préfère ne pas en dire plus sur son activité professionnelle. En revanche, il s’amuse du groupe de militaires qu’il vient de voir traverser le hall de l’aéroport.
« Sûrement d’Afrique du Sud, indique-t-il sans hésiter. Ces mallettes, je les connais bien. Fusils pour snipers. Les petites grises, c’est pour les munitions. » Pourquoi l’Afrique du Sud ? « Vous avez vu leurs têtes ? Tous blancs. Ce sont des mercenaires formés là-bas. Tarif : de 1 000 à 1 500 dollars par jour. »
Le soir même, de retour à Paris, j’apprends que le président Ben Ali s’est adressé pour la troisième fois aux Tunisiens. Le visage cette fois marqué, le président annonce la libération des personnes arrêtées lors des affrontements avec la police et la fin de la censure sur l’information. Rien n’y fait. Le bilan de la FIDH atteint à présent soixante-six morts. Un point de non-retour a été franchi. Malgré le nouveau couvre-feu, des émeutes se poursuivent à Tunis et dans le reste du pays. Vingt-quatre heures plus tard, après un ultime discours, en arabe dialectal cette fois, au cours duquel il assure qu’il ne se présentera plus en 2014, Ben Ali fuit la Tunisie…
Karim m’a quitté le jeudi 13 janvier avant mon départ pour l’aéroport. Je tiens à le remercier vivement pour les risques qu’il a accepté de prendre en m’accompagnant. Père de famille, emprisonné à deux reprises par la police de Ben Ali, nul mieux que lui ne savait ce dont la police tunisienne est capable. Depuis le 14 janvier, il m’envoie chaque jour des informations.
Sans son aide, comme celle de Wael avant lui, je n’aurais jamais pu rester en Tunisie jusqu’au 13 janvier et recueillir tous ces témoignages. Je tiens également à remercier tous les Tunisiens et les Tunisiennes qui ont accepté de me parler pendant mon séjour.
 Combien ça coûte, une Révolution ? (18.01.2011)
Combien ça coûte, une Révolution ? (18.01.2011)
78 morts, 94 blessés et 3 milliards de dinars. Voilà, en peu de mots, ce qu’aura coûté, à l’heure qu’il est, la
révolution tunisienne.
Le cynique amalgame effectué par le ministre de l’intérieur nommé il y a quelques jours par Ben Ali entre les morts (forcément sous-estimés) et les pertes financières est repris sans sourciller
par une grande partie de la presse française et étrangère, relayant ainsi les inquiétudes des investisseurs (« Tunisie, la grande angoisse des entreprises françaises », Le
Point). Ces 3 milliards équivaudraient, si l’on en croit les calculs de l’AFP relayés par Le
Figaro, à 4% du PNB national. Il est évidemment tentant de dire que les droits de l'homme ne s'achètent pas, mais les bons sentiments ne
convainquent plus personne. Alors, discutons.
Le constat chiffré du ministre de l'intérieur est fondé sur deux présupposés que l’on peut examiner à la lumière de l’histoire. Le premier est d’ordre économique : les Tunisiens qui ont participé
aux manifestations, aux révoltes et aux pillages sont responsables de l’effondrement de l’économie tunisienne. Le second est d’ordre politique : la Révolution est aujourd’hui terminée, puisqu’il
est d’ores et déjà possible d’en faire un bilan.
Ces deux affirmations ont un air de déjà vu.
La première est une énième version des débats qui divisent les experts sur les conséquences économiques des révolutions. Pour une partie des historiens de l’économie, la période révolutionnaire
aurait ainsi ruiné l’économie française et favorisé le décollage industriel de l’Angleterre, sa grande rivale, au 19e siècle. Ces thèses catastrophistes sont aujourd’hui en majorité contestées,
du moins relativisées : si la Révolution a incontestablement freiné la croissance, elle a surtout hérité de la crise et des inégalités de l’Ancien Régime et s’est surtout traduite par un
ralentissement de la croissance globale. De même, sous-entendre que la Révolution tunisienne est responsable de la crise économique est un comble, puisque c’est évidemment le pillage du pays par
l’Etat et les clans au pouvoir qui a provoqué la Révolution tunisienne.
La seconde affirmation nous renvoie à l’obsession de nombreux hommes d’Etat de la fin du 18e siècle, de terminer la Révolution, non seulement pour briser le cycle de la violence, mais aussi pour
garder le pouvoir et, parfois, éviter de rendre des comptes. Ainsi, on ne peut que comprendre le ministre de l’intérieur tunisien, membre d’un gouvernement d’ancien régime aujourd’hui contesté
dans la rue, lorsqu’il tente de faire croire à une simple parenthèse, à un accident de l’histoire. Pourtant, il est encore bien trop tôt pour que M. Ahmed Friaa puisse s’imposer en Tunisie comme
Bonaparte l’avait fait en 1799, après une décennie entière de Révolution, en proclamant " Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie ".
Les manifestations qui continuent semblent le montrer : dresser dès aujourd’hui un bilan de ce qui est en train de se produire est impossible. Dans l’histoire, contrairement à l’image romantique
que l’on s’en fait, les révolutions ressemblent généralement plus à des marathons qu’à des courses de vitesse, pour le meilleur... mais aussi parfois pour le pire.
15:07 Ecrit par Guillaume Mazeau
Une révolution tunisienne (14.01.2011)
Boston, 1765. Le jeune George III d’Angleterre, despote considéré comme éclairé, impose de nouvelles taxes sur les produits de
base et provoque de violentes émeutes. Boston, 1770. A l’issue d’une nouvelle insurrection, les soldats tirent sur la foule. Le « massacre de Boston », aussitôt dénoncé à l’opinion par les médias
patriotes, restera dans les mémoires comme la première fête nationale américaine. Cinq ans plus tard, en 1775, c’est le début d’une guerre d’indépendance qui aboutit à une des premières
révolutions du monde moderne.
Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, des émeutes de la faim, plus connues sous le nom de « Guerre des Farines », secouent tout le Bassin Parisien et contribuent de manière décisive,
jusqu’en 1789, à précipiter la crise dans laquelle le royaume s’enlise depuis plusieurs années. Plus de deux cents ans plus tard, l'histoire bégaie-t-elle?
Tunisie, 17 décembre 2011. Mohamed Bouazizi, jeune vendeur ambulant dont la marchandise vient d’être saisie par la police, s’immole par le feu, bientôt imité par d’autres gens de peu. Ils
deviennent aussitôt les premiers martyrs d'un peuple en Révolution. Dans les régions les plus pauvres du pays, puis dans les faubourgs de Tunis, la hausse des prix alimentaires aura là aussi
réveillé la contestation sociale, puis celle du régime tout entier, révélant la souffrance d’un peuple que l'on prétendait pourtant gouverné par un régime modèle. En 1775, les émeutiers pillaient
en réclamant un juste prix. En Tunisie, que l'on a décrit comme un pays de démocrates sans démocratie, les acteurs de la nouvelle "Guerre du pain", issus des classes moyennes diplômées, sont
encore plus politisés ne saccagent pas à l'aveugle, mais visent en priorité les magasins appartenant à la ploutocratie, en particulier à la famille du dictateur. Par leur relative retenue, les
jeunes Tunisiens démentent tous les clichés péjoratifs sur les foules révolutionnaires. Jouant le rôle de la littérature clandestine et des images prohibées de la fin du 18e siècle, internet et
la cyber-résistance auront joué un rôle central dans la mobilisation populaire, la conquête de la liberté d'expression et la désacralisation du pouvoir, avant même sa chute.
Le départ de Ben Ali serait une nouvelle prise de la Bastille, disent certains. Les références à la Révolution française relèvent pourtant d'un néocolonialisme réducteur et dangereux. Le 14
janvier 2011 n'est pas un nouveau 14 juillet 1789. Cette révolution est tunisienne et non un avatar de la Révolution française. Le contexte est très différent: la mondialisation, le rôle de
l'armée, des femmes, des classes moyennes, les logiques postcoloniales et l'ombre de l'islamisme font de la Révolution tunisienne un évènement sans pareil, même s'il présente certains mécanismes
communs à d'autres révolutions.
Un pauvre vendeur de fruits et légumes aura donc fait chuter Ben Ali et la date du 14 janvier 2011 restera dans l’histoire comme celle de la « Révolution du Jasmin », gagnée dans le sang… et,
c'est le propre des révolutions, aussitôt rongée par le doute.
23:12 Ecrit par Guillaume Mazeau
 Paru dans Libération du 31/08/2010 à 00h00
Paru dans Libération du 31/08/2010 à 00h00
La sécurité de Sarkozy n’est pas la sûreté de la Révolution
Par GUILLAUME MAZEAU Maître de conférences à l’université Paris-I
Interviewé sur France Inter le 23 août, le ministre de l’Immigration a ainsi défendu le tour de vis sécuritaire annoncé par Nicolas Sarkozy : «C’est comme ça que s’est construite la Révolution. Ce qu’on appelait […] la sûreté, aujourd’hui on dirait la sécurité, c’était bien la loi qui protège, l’Etat qui protège les faibles, les opprimés et les plus fragiles, et c’est toujours le cas dans notre société.»
En établissant cette filiation, Eric Besson tente de démontrer que l’actuelle politique sécuritaire ne trahit pas les valeurs républicaines mais qu’au contraire, elle les garantit. Ainsi présentées, les lois sur la sécurité annoncées cet été par Nicolas Sarkozy seraient même fidèles à l’esprit de la Révolution française, puisque selon Eric Besson, ces lois rappellent que le premier devoir de l’Etat est de protéger les citoyens les plus vulnérables.
Il est pourtant impossible d’amalgamer la notion de «sûreté», telle qu’on l’employait au XVIIIe siècle et celle de «sécurité», telle qu’on l’entend aujourd’hui. En 1789, une des premières urgences des révolutionnaires était d’éliminer les atteintes à la liberté individuelle : les arrestations décidées de manière arbitraire étaient devenues les marques les plus honnies du despotisme monarchique.
Dès le 26 août, la sûreté est ainsi inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme un des droits naturels et imprescriptibles (art. 2). Inspirée de l’exemple anglais (l’Habeas corpus de 1679 interdit d’être emprisonné sans jugement) puis popularisée par les penseurs des Lumières, la notion de sûreté individuelle est alors définie comme la garantie qu’a toute personne de ne pas être détenue arbitrairement, mais selon les formes et conditions prévues par la loi
La défense de la «sûreté» des personnes, qui vise à protéger les individus contre l’arbitraire de l’Etat, n’a donc rien à voir avec la notion de «sécurité» telle que l’emploie Eric Besson.
Le terme de «sécurité» ne s’est imposé que depuis les années 1980 pour désigner le droit à être protégé des violences civiles. Ainsi associé au maintien de l’ordre public, il se rapproche davantage de ce qu’au Siècle des lumières, on nommait «tranquillité publique» ou encore «sûreté générale». Mais, surtout depuis la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, ce droit est désormais compris dans son sens le plus restrictif : le devoir de l’Etat est de protéger les citoyens et leurs biens contre les délinquants, quitte à menacer la sûreté des personnes (fouilles, contrôles d’identité, fichage ADN…). En assimilant la sécurité à la protection des droits fondamentaux de l’homme, Eric Besson ne fait ainsi que reprendre une stratégie électoraliste déjà tentée par le garde des Sceaux Alain Peyrefitte, qui affirmait en 1980 devant la montée de la gauche : «La sécurité est la première des libertés.» (Guillaume Mazeau est membre de l'Institut d’histoire de la Révolution française, membre du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (Cvuh)