 «Aucun parti communiste n'est né au
congrès de Tours» "Mediapart)
«Aucun parti communiste n'est né au
congrès de Tours» "Mediapart)
30 Décembre 2010 Par
Lénaïg Bredoux 
Le temps était au froid, brumeux, ce jour de Noël 1920 quand les
285 délégués du XVIIIe congrès de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO) ont emprunté la rue nationale jusqu'à la salle du manège de Tours, décorée d'un buste du fondateur
disparu, Jean Jaurès, et surplombée d'une large banderole proclamant «Prolétaire de tous pays unissez-vous».
Dès l'ouverture des travaux, en début de matinée du samedi 25
décembre, l'ambiance est électrique, l'ordre du jour modifié, les discours parfois à peine audibles, entre les partisans de la Russie soviétique, conduits par Louis-Oscar Frossard et Marcel
Cachin, et les tenants d'une ligne plus réformatrice, emmenés par Léon Blum.
Tous doivent répondre à une question cruciale: faut-il adhérer à
la IIIe Internationale, fondée par les Bolcheviks qui ont pris le pouvoir à Moscou? Les débats vont durer six jours, exténuants, tendus, comme en témoigne Blum qui lance à la salle: «J'ai
naturellement une voix très faible. Je suis, d'autre part, très fatigué, comme vous tous, et il me serait matériellement impossible de surmonter par la force de mon gosier et de mes poumons le
tumulte et les interruptions violentes.» Mais l'issue du vote ne fait guère mystère. Et Blum le sait. Ses premiers mots: «Je demande au congrès d'avoir égard à ce qu'il y a d'ingrat dans
la tâche que mes camarades m'ont confiée devant une assemblée dont la résolution est arrêtée, dont la volonté d'adhésion est fixée et inébranlable.»
Il sait que les représentants des 89 fédérations, dont celle
d'Oran, de Tunisie ou des «camarades annamites», qui se sont relayés à la tribune ont déjà dit qu'ils étaient majoritairement favorables à l'alignement sur Moscou. Il sait que la Grande
guerre, et l'Union sacrée finalement votée par les héritiers de Jaurès, ont laissé des traces profondes, particulièrement auprès des jeunes militants, nombreux dans la salle du Manège. Il sait
aussi qu'ils pensent pour partie que les errements de la direction socialiste sont dus à sa forte composante intellectuelle, et qu'ils rêvent de révolution.
«Vous êtes jeunes, camarades», leur lance Marcel Sembat. Cachin, lui, raconte son voyage en Russie: «Nous avons vu vivre la grande nation. (...) Et nous avons assisté à un spectacle
qui devait nous émouvoir jusque dans nos fibres les plus intimes de socialistes chevronnés. C'est celui d'un grand pays, le plus grand de l'Europe, radicalement débarrassé de toute bourgeoisie,
de tout capitalisme, dirigé uniquement par les représentants de la classe ouvrière et de la classe paysanne.» L'enthousiasme est de son côté.
Blum lui termine, ému, un très long discours par ces mots:
«Nous sommes convaincus au fond de nous-mêmes que, pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. (...) C'est sans doute la dernière
fois que je m'adresse à beaucoup d'entre vous et (...) il faut pourtant que cela soit dit. Les uns et les autres, même séparés, restons des socialistes; malgré tout, restons des
frères, des frères qu'aura séparés une querelle cruelle, mais une querelle de famille, et qu'un foyer commun pourra encore réunir.»
Le 30 décembre à Tours, les «frères» se séparent, la
Section française de l'Internationale communiste (SFIC) est née, préfigurant le PCF. La motion favorable aux thèses bolcheviques a recueilli 70% des mandats.
"Aucun parti communiste n'est né au congrès
de Tours"
Quelle place tient le congrès de Tours dans l'histoire
du PCF?
C'est un mythe. Le PCF comme beaucoup d'autres entités collectives
s'est doté d'un récit des origines qui vise à lui conférer une identité qui le différencie des autres et dans laquelle il peut projeter une naissance glorieuse, peu à peu élevée au rang
d'événement fondateur. Mais aucun parti communiste n'est né au congrès de Tours. Ce congrès de la SFIO devait prendre position sur la proposition faite par les Bolcheviks d'intégrer une nouvelle
internationale. De la scission majoritaire, qui vote l'adhésion à l'Internationale communiste, sort une Section française de l'Internationale communiste (SFIC). Ce n'est que plus tard qu'il
s'appellera vraiment Parti communiste (et seulement en 1943 qu'il prendra le nom de PCF). Le premier secrétaire du nouveau parti Louis-Oscar Frossard dira d'ailleurs à la fin des années 1920
qu'il n'avait «jamais été communiste». Les militants qui votent l'adhésion à la nouvelle internationale n'adhèrent pas à ce qui se passe à Moscou en 1920, ils le connaissent d'ailleurs très mal.
Ils projettent plutôt sur le parti bolchevik l'idée qu'il valorise le militant ouvrier, l'esprit de discipline, contre les intellectuels socialistes qui ont «trahi» en votant l'Union sacrée
pendant la guerre de 14-18.
A quand remonte alors la naissance du PCF
?
Ce parti, qui sort du congrès de Tours, ne deviendra réellement
Parti communiste qu'à partir des années 1925-1930. Il se décante à l'issue de longues luttes internes et de multiples interventions du parti bolchévik qui provoquent d'incessants changements de
direction. A partir de 1930-1931, le groupe dirigeant se stabilise, avec le tout jeune Maurice Thorez (secrétaire général du parti de 1930 à 1964). Les cadres thoréziens vont ensuite rester
jusque dans les années 1970, avec Duclos et Waldeck-Rochet. A partir de ce moment-là aussi, l'assujettissement à Moscou, où le parti bolchevik a définitivement conquis le pouvoir, et
l'homogénéisation de la formation politique se mettent en place. Ce processus va conduire à la promotion des cadres thoréziens et derrière eux de milliers de cadres issus des milieux
populaires.
C'est cette spécificité du PCF qui vous conduit à le qualifier de parti démocratique. A l'opposé de son image traditionnelle.
C'est une spécificité dans l'histoire politique dans la mesure où
la démocratie se caractérise par le fait que les représentants sont peu représentatifs de ceux qu'ils sont justement censés représenter. De ce point de vue, les communistes ont permis une
démocratisation incontestable de l'action politique. Et suscité un immense bonheur, le «bonheur communiste» ou la «renaissance» évoquée par Jeannette Vermeersch. Il suffit par exemple de penser à
Martha Desrumaux, qui a dirigé sa première grève en 1917 en étant analphabète et qui écrira ensuite dans plusieurs journaux. Mais le prix à payer, qui va se révéler progressivement, c'est le
stalinisme. Celui-ci s'est justement construit en promouvant ce genre de personnels, y compris en Union soviétique.
Combien de temps dure ce «bonheur communiste»?
Cette matrice tient la route jusqu'en 1956. Elle était associée à
la déification du guide infaillible, qui s'effondre avec le rapport Khrouchtchev qui produit un choc phénoménal dans le PCF. On déboulonne alors ce qui faisait tenir le régime de vérité de la
matrice stalinienne. Celle-ci va continuer mais au prix d'adaptations. On va alors assister à des débats sans fin entre les philosophes communistes pour refonder une légitimité communiste, on va
voir monter de plus en plus d'intellectuels. La matrice continue, mais elle est minée par le déboulonnage de Staline. La question n'est donc plus aujourd'hui de savoir si le PCF est mort: il
n'existe plus depuis longtemps. L'appareil politique continue d'exister, il fonctionne encore aujourd'hui, mais en tant que parti stabilisé, associé à un mouvement stalinien, c'est terminé depuis
1956.
Le PCF n'a-t-il pas pourtant contribué à produire une contre-société pendant des décennies, notamment dans les municipalités gérées par des communistes, en promouvant la culture et
l'éducation populaire?
Les communistes avaient le sentiment en partie fondé, notamment
dans la banlieue rouge, d'avoir construit leur monde, avec un grand bonheur, lié à des sociabilités, des moments de luttes partagées etc. Il y avait un réformisme social très fort. Mais il ne
faut pas exagérer ce bonheur communiste collectif: il ne concernait qu'une partie de la population, y compris dans ces villes là; les immigrés étaient parfois vus comme des obstacles. Il faut
être prudent avec la logique selon laquelle le PCF a certes été stalinien mais qu'il a aussi fait les colonies de vacances... C'est vrai, mais cela peut avoir pour fonction le refoulement du
stalinisme. Il faut tenir les deux bouts, et indiquer que ces deux phénomènes sont imbriqués dans la même histoire.
Après 1956, vous parlez d'une nouvelle rupture en 1977, avec le début de l'hémorragie militante. Comment l'expliquez-vous?
La crise profonde c'est 1956. Mais commence ensuite une période
chanceuse pour le PCF d'union de la gauche avec un effet de politisation très fort après 1968. Mais tout s'arrête avec la décision bureaucratique de la rupture avec le PS. Depuis, on vit une
longue période de navigation à vue dans les rapports aux socialistes, et une hémorragie progressive des militants qui s'achève avec le départ de Marchais. Robert Hue et Marie-George Buffet sont
ensuite deux faces de la gestion d'une entreprise de modernisation, mais d'une modernisation de façade. Le système d'action communiste se disloque, avec la perte des journaux, de maisons
d'édition, de centres de pensée intellectuelle. Il ne reste qu'un parti, quelques municipalités et encore un peu de ressources électorales, dans un fonctionnement de pilotage automatique. C'est
d'ailleurs très difficile d'avoir aujourd'hui une vue du PCF, avec des militants vieillissants, qui résistent aux transformations et sont incapables de penser une nouvelle histoire de leur parti.
Au final, le PCF est en train de devenir l'objet d'une OPA de Mélenchon...
«Le communisme ne se réduit pas au
PCF»
A contrario des images d'Epinal sur le PCF, vous
décrivez dans votre livre une diversité du militantisme communiste en France. Comment se manifestait-elle?
Les pratiques militantes se sont adaptées aux différents
territoires et ont été appropriées par les différents groupes sociaux. L'appareil central a bien produit un modèle général mais ces normes militantes, en s'appliquant, se sont transformées. Par
exemple, selon ce modèle, un ouvrier communiste doit militer en priorité dans sa cellule d'entreprise. Or ces structures fonctionnent en réalité très mal et les militants voient les entreprises
avant tout comme le lieu de leur engagement syndical. Contrairement aux consignes, ils militent à la CGT dans leur usine et au PCF dans leur localité. Autre exemple, il y avait au PC une adhésion
paysanne très forte, souvent faite de petits propriétaires, sur la base de la défense des coopératives ou de l'exploitation familiale, en décalage avec le discours marxiste-léniniste sur
l'abolition de la propriété privée et le collectivisme.
Pourquoi garde-t-on encore aujourd'hui en mémoire cette image d'un militantisme ouvrier stalinien discipliné?
Les dirigeants communistes ont défendu l'image du PCF comme Parti
de la classe ouvrière, insistant sur l'unité du Parti et dissimulant toute la diversité de la classe ouvrière. De ce point de vue, le travail idéologique et symbolique du PCF a été très efficace,
relayé ensuite par les journalistes et les commentateurs. A tel point que quand le PCF a décliné, on a eu l'impression que la classe ouvrière avait disparu. On a aussi surestimé l'encadrement par
l'appareil du PCF dans ce que l'on a appelé les «fiefs ouvriers» ou les «bastions rouges». En réalité, les élus y avaient un pouvoir relativement important, les syndicalistes pouvaient bénéficier
d'une certaine autonomie, et les cadres de l'appareil n'étaient pas toujours en mesure d'imposer leur politique.
Quel est, dans ce cadre, l'apport le plus important du PCF dans sa longue histoire?
Il a permis à des catégories populaires de participer à la vie
publique alors que ces catégories sont généralement exclues de la vie politique. Le PCF fut un outil formidable de promotion pour des ouvriers et des paysans, qui sont devenus élus, responsables
d'associations, ont côtoyé des intellectuels, suivis des formations, etc. Aucun autre parti en France n'a effectué une telle opération. Et ce phénomène repose sur une inscription dans les
réalités des classes populaires. La grande force du PC était d'être au centre de multiples réseaux, qui ne dissociaient pas les luttes syndicales, les luttes politiques et le travail dans le
monde associatif comme le Secours populaire ou les comités de locataires (CNL). Cette sociabilité très riche reposait sur un discours de mise en relation des réseaux (politiquement tout était
lié), souvent par les liens familiaux: il arrivait qu'un frère dirige la section syndicale, quand l'autre était maire et que l'épouse dirigeait la cellule locale...
A partir de quand ces sociabilités se sont-elles délitées ?
Avant de décliner, elles se sont transformées: à partir de la fin
des années 1960 et dans les années 1970, des catégories plus diplômées, comme les enseignants ou les animateurs socio-culturels, viennent militer au PCF. L'ouverture sociale est alors très
importante, avec des intellectuels diplômés qui dirigent des sections ou deviennent maires. La rupture du programme commun (1977) s'accompagne ensuite d'un rejet de ces nouvelles catégories et un
retour de l'ouvriérisme, mais dans une version misérabiliste portée par des dirigeants qui sont de moins en moins des ouvriers et qui sont produits par l'institution, souvent fils d'anciens
dirigeants. A partir de là, le déclin est très fort et l'hémorragie militante commence.
Que reste-t-il du PCF et de son ancrage local ?
Ce sont des élus. Les réseaux autrefois liés au parti
(municipalités, associations, syndicats) ont éclaté et se sont autonomisés. Les représentants du PCF sont aujourd'hui essentiellement des élus dans les conseils régionaux ou généraux, qui sont en
même temps responsables des fédérations, ce qui était impensable avant la fin des années 1980.
Cette dislocation des réseaux communistes a-t-elle été continue depuis trente ans ?
Le déclin est continu mais on peut noter certaines évolutions.
Notamment dans les années 1990, quand le PCF s'est ouvert à la «société civile» pour pallier le déclin de ses réseaux et de l'appareil, dans le cadre d'une primauté donnée à la stratégie
électorale. C'était par exemple la liste Bouge l'Europe conduite par Robert Hue aux élections européennes de 1995. Le PCF essaie de se renforcer en valorisant des personnalités, qui agissent en
leur nom propre, et moins en travaillant les réseaux qui existent encore, comme ceux de la CGT. On met donc de côté la lutte des classes et la valorisation des classes populaires pour insister
sur l'antiracisme, l'écologie, le féminisme ou le discours humaniste. Le PCF a finalement été pris dans l'idéologie dominante des années 1990 et a perdu sa singularité de discours de classe dans
le paysage politique. Aujourd'hui le plus important pour lui, ce sont ses élus, parce qu'ils font la visibilité du parti. Ce sont d'ailleurs plutôt eux qui décident de la politique du PCF et non
plus l'appareil en tant que tel. De ce point de vue, le PCF devient un peu comme le PS.
Peut-on dire qu'aujourd'hui, le PCF, dans sa diversité, est mort?
Le PCF tel qu'il a été fondé au congrès de Tours est mort.
L'organisation militante qui a fonctionné des années 1920 aux années 1970 n'existe plus. Le nom est le même mais le parti n'est plus structuré de la même manière. La rupture fondamentale a
sûrement eu lieu à la fin des années 1970, avec la perte de deux dimensions constitutives du PCF fondé en 1920, la centralité ouvrière et la centralité militante. La première assurait la primauté
des militants d'origine ouvrière dans l'appareil. La seconde faisait que l'identité communiste structurait l'engagement syndical, associatif et municipal des militants. Mais, en se nommant
toujours Parti communiste, cette organisation conserve un monopole symbolique sur une étiquette qui a plutôt une image positive en France. Il y a en effet toujours dans le pays une sorte de
culture « communiste » qui se maintient, notamment dans les milieux syndicaux et associatifs, dans les réseaux de la gauche de la gauche, entre le PS et l'extrême gauche. Elle ne se matérialise
plus automatiquement dans l'appartenance au PCF, ni même forcément dans le vote pour ses candidats, mais elle est basée sur des valeurs communes de progrès et le souvenir des conquêtes sociales.
Ces valeurs se maintiennent, comme on a pu le voir lors du mouvement de défense de la retraite à 60 ans, mais elles n'ont plus aujourd'hui de réceptacle politique évident. Le communisme
aujourd'hui ne se réduit pas au PCF.
 Fondation Jean Jaurès. Le dossier réalisé par la fondation Jean-Jaurès (proche du PS), avec notamment l'intégralité des débats du congrès de Tours et les liens avec les discours
Fondation Jean Jaurès. Le dossier réalisé par la fondation Jean-Jaurès (proche du PS), avec notamment l'intégralité des débats du congrès de Tours et les liens avec les discours
23/12/2010 à 00h0
 «Le PCF doit prendre à bras-le-corps son histoire»
«Le PCF doit prendre à bras-le-corps son histoire»
Interview
Le Parti communiste français fête ses 90 ans. Romain
Ducoulombier, historien, retrace son évolution :
Par LILIAN
ALEMAGNA
Romain Ducoulombier, historien, est l’auteur de
Camarades ! La naissance du Parti communiste en France (Perrin, 2010). Il revient sur les raisons de la scission, il y a quatre-vingt-dix ans, à Tours, de la SFIO et estime
que si «l’idée communiste n’a pas de raison de mourir», le «communisme du XXIe siècle doit encore se composer».
Quelles sont les origines du Parti
communiste en France ?
Sa naissance officielle date de la toute fin
décembre 1920 à Tours, lorsque la majorité des socialistes de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) adhère à la IIIe Internationale et crée la
Section française de l’Internationale communiste (SFIC). Mais ce congrès de Tours n’est que l’aboutissement d’un processus de crise qui touche la SFIO durant la Première Guerre mondiale.
D’une part, les socialistes se divisent sur la participation au gouvernement d’«Union sacrée». La colère prend de l’ampleur en 1915-1916. D’autre part, dans le parti, les socialistes ont un
besoin de rénovation de leurs principes et de leurs pratiques politiques. Ils veulent absolument revenir aux principes «antiministérialistes» et débarrasser le parti de ses
«sociaux-patriotes». Et rénover et nettoyer le parti de ses mauvais bergers, donner une nouvelle jeunesse à une formation bouleversée par la guerre.
Dans votre livre, vous dites que le PCF
est aujourd’hui un «astre mort». Pourtant, quatre-vingt-dix ans après sa naissance, le parti existe encore…
Je ne dis pas que le PCF est mort. J’utilise cette image
pour évoquer son parcours historique exceptionnel et illustrer la lumière qu’il projette encore. Le PCF a été capable d’offrir un modèle nouveau de parti politique en France. Il a
modernisé les pratiques militantes, mais cette modernisation a pris dès l’origine une tournure autoritaire. Il a été capable, avec le temps, de réunir deux conditions nécessaires à la
constitution d’un parti ouvrier : un lien fort avec les syndicats et la promotion d’une nouvelle élite ouvrière. Ni totalitaire ni social-démocrate, le PCF va réussir à s’implanter
dans la société française et offrir un modèle qui va fonctionner. Reste qu’aujourd’hui le PCF ne se porte pas très bien. Il a du mal à proposer une offre politique différente de
ses concurrents de «la gauche de la gauche».
Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, parle pourtant de
«communisme du XXIe siècle»…
L’idée communiste n’a pas de raison de mourir. Elle est
liée à la révolte contre les inégalités, à l’idée de démocratie. Mais le PCF doit prendre à bras-le-corps son histoire, car ses succès, son financement, ont toujours dépendu à la fois de
Moscou et de ses élus. Or, une des grandes défaites du PCF est d’avoir perdu la bataille municipale. Cela permettait de défendre sa conception d’un socialisme local et d’entretenir
l’appareil. Les bastions locaux, moyens de résistance, se réduisent comme peau de chagrin. Du coup, le «communisme du XXIe siècle» doit encore se composer, car
l’ère du messianisme prolétarien, qui prend fin avec le «moment Soljenitsyne» dans les années 70, est terminée. Le mouvement ouvrier français a vécu dans le mythe d’une classe ouvrière
libératrice de l’humanité. Ce mythe est épuisé.
Le PCF est vieillissant mais dans les
cortèges cet automne on a vu les Jeunes communistes. Signe d’une relève ?
Il n’y a pas de raisons que la contestation cesse et que les
générations ne se renouvellent pas. Les militants de 1920 ont d’ailleurs un point commun avec les nouvelles générations anticapitalistes et antilibérales d’aujourd’hui - qu’elles
soient au PCF ou non : un besoin de dépasser les appareils et celui de servir.
D’où le dilemme du PCF - vouloir garder la forme parti ou la
dépasser -, ce qui aboutit au Front de gauche ?
Le PCF était une force plébéienne appuyée sur un fort
ancrage local. Mais son monopole s’est effondré : il est concurrencé à gauche comme à droite, où le FN apparaît lui aussi comme un porte-parole «populiste», mais sans ancrage local.
Pour le Front de gauche, il faut voir si le PCF est capable d’imposer une nouvelle orientation morale, en toilettant son image, sans être utilisé par ses alliés. Le parti offre ce qui reste
de son assise locale pour porter sur la scène nationale un tribun qui ne vient pas de ses rangs : Jean-Luc Mélenchon. Reste à voir si cette combinaison peut réussir. Ce sera le test de
la présidentielle.
 « Les Etats créent les nations, pas l’inverse »
« Les Etats créent les nations, pas l’inverse »




 Les écrivains face à la Commune
Les écrivains face à la Commune  L’explication d’un document écrit
L’explication d’un document écrit
 Vichystes et pourtant résistants
Vichystes et pourtant résistants
 1940: une hostilité inorganisée à l'occupant
1940: une hostilité inorganisée à l'occupant «Aucun parti communiste n'est né au
congrès de Tours»
«Aucun parti communiste n'est né au
congrès de Tours»
 Fondation Jean Jaurès. Le
Fondation Jean Jaurès. Le 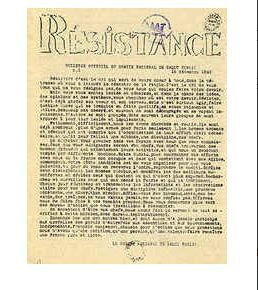
 Discours de Bordeaux, 9 octobre 1852
Discours de Bordeaux, 9 octobre 1852

 Face au chaos économique la CG.T proclame l’urgence d'assurer la justice sociale dans la souveraineté du Travail
Face au chaos économique la CG.T proclame l’urgence d'assurer la justice sociale dans la souveraineté du Travail