 Découverte du texte original établissant un
statut pour les juifs sous Vichy
Découverte du texte original établissant un
statut pour les juifs sous Vichy
LEMONDE.FR avec AFP | 03.10.10 | 10h27 • Mis à jour le 04.10.10 | 15h24
L'avocat Serge Klarsfeld a annoncé, dimanche 3 octobre, la découverte du document original établissant un statut des juifs en octobre 1940. Ce document de l'Etat français est annoté de la main du maréchal Philippe Pétain, qui durcit considérablement des mesures déjà "extrêmement antisémites". Selon M. Klarsfeld, les annotations du maréchal Pétain "remanient profondément" la nature du document.
Le texte vise tous les juifs, français ou étrangers, alors que le projet initial prévoyait d'épargner "les descendants de juifs nés français ou naturalisés avant 1860". Le maréchal Pétain décide en effet de rayer cette mention. Le champ d'exclusion des juifs est également considérablement élargi. La justice et l'enseignement leur sont désormais totalement fermés. De plus, ils ne peuvent plus être élus. Enfin, le maréchal conclut ces "mesures antijuives" en demandant que "les motifs qui les justifient" soient publiés au Journal officiel.
L'ÉCRITURE DE PÉTAIN
"La découverte de ce projet est fondamentale. Il s'agit d'un document établissant le rôle déterminant de Pétain dans la rédaction de ce statut et dans le sens le plus agressif, révélant ainsi le profond antisémitisme" du chef du gouvernement de Vichy, explique Serge Klarsfeld. Son fils, Arno Klarsfeld, assure qu'il ne fait "aucun doute" que l'écriture retrouvée sur le document est celle de Philippe Pétain après des comparaisons avec celle d'autres textes manuscrits signés du maréchal. "Le principal argument des défenseurs de Pétain était de dire qu'il avait protégé les juifs français. Cet argument tombe", constate Serge Klarsfeld, précisant que le texte a été remis par un donateur anonyme au Mémorial de la Shoah.
La cinquième feuille du projet, rapporte M. Klarsfeld, indique le lieu de sa rédaction et la fonction de ses rédacteurs : "Fait à Vichy, par le maréchal de France, chef de l'Etat, le vice-président du Conseil" et huit autres ministres. Il n'y a ni date, ni noms, ni signatures. Le projet de loi a été débattu lors du conseil des ministres du 1er octobre 1940, puis adopté le 3 octobre. Sa version promulguée au Journal officiel, le 18 octobre 1940, comporte tous les ajouts du maréchal Pétain, y compris "les motifs" justifiant les mesures.
"PREUVE DÉFINITIVE"
Jusqu'ici, les historiens ne pouvaient se référer qu'à un seul témoignage, en ce qui concerne Pétain et le statut des juifs, celui de l'ancien ministre des affaires étrangères de Vichy, Paul Baudouin. Dans un livre publié en 1946, ce dernier écrivait que lors du conseil des ministres du 1er octobre 1940, le gouvernement avait étudié "pendant deux heures le statut des israélites. C'est le maréchal qui se montre le plus sévère. Il insiste en particulier pour que la justice et l'enseignement ne contiennent aucun juif".
"Le témoignage de Baudouin était formel, mais on pouvait le mettre en doute. Maintenant, on a la preuve définitive que le statut des juifs relève de la volonté personnelle du maréchal Pétain, souligne M. Klarsfeld. Le statut des juifs est une mesure spécifiquement française, spontanée. Les Allemands n'avaient pas demandé à la France de Vichy de prendre ce statut. Mais il y a eu une concurrence entre l'antisémitisme français et l'antisémitisme allemand."
"L'antisémitisme de Pétain est un antisémitisme traditionnel"
LE MONDE pour Le Monde.fr | 04.10.10 | 12h29 • Mis à jour le 04.10.10 | 20h29
L'intégralité du débat avec Laurent Joly, chargé de recherche au CNRS, spécialiste du
régime de Vichy, lundi 4 octobre, à 16 h .
Pierre : Qui étaient les personnes (leurs
fonctions) qui ont rédigé le texte soumis à Pétain ?
Laurent Joly : Très longtemps, dès la Libération, on accuse Raphaël Alibert, ministre de la justice, proche du maréchal Pétain, d'être l'unique auteur du statut.
En réalité, il semble que ce texte, ce soit le ministre de l'intérieur, Marcel Peyrouton, qui l'ait rapporté en conseil des ministres, et ce texte a donc été probablement préparé par ses collaborateurs.
L'élaboration du texte final est une oeuvre gouvernementale. On sait que le maréchal Pétain est intervenu, au moins sur la question des enseignants et des magistrats.
Un passant : Pourriez-vous revenir sur les circonstances de l'adoption du statut des juifs ?
D'abord, l'idée d'un statut des juifs est tout de suite présente dans le Vichy de juillet 1940.
Par exemple, Raphaël Alibert, qui est nommé garde des sceaux dans le premier gouvernement de juillet 1940, se vante de préparer un statut qu'il définit "aux petits oignons".
Et de tout horizon, on s'attend à ce que Vichy adopte une loi, un statut qui serait spécifique pour les juifs. Or, ce n'est pas cette solution que le gouvernement choisit au départ.
Il préfère sans doute - et sur ce point Pierre Laval, vice-président du Conseil, calcule qu'une loi raciale passerait mal dans l'opinion - le détour de mesures générales qui visent les naturalisés, les "Français de fraîche date".
Pour résumer, les Français nés de père étranger peuvent être licenciés de leurs emplois dans la fonction publique, et surtout, dans deux professions, qui n'ont pas été choisies au hasard : le barreau et la médecine, lesquelles, selon la propagande antisémite, étaient envahies par les juifs depuis l'entre-deux-guerres.
D'autre part, en juillet 1940, Vichy a adopté une loi de révision des naturalisations, dont - Patrick Veil l'a démontré - l'application visera principalement les juifs. Dans les décombres, Lucien Rebatet, fasciste et antisémite acharné, se félicite d'ailleurs de ces lois qui règlent le problème juif sans avoir l'air d'y toucher.
Tout bascule en septembre 1940. Le 10 septembre, le gouvernement apprend que les autorités allemandes préparent une ordonnance générale sur les juifs.
L'idée d'un statut revient donc au premier plan, car dans l'esprit de Vichy, il s'agit à la fois de montrer aux Allemands que l'on peut régler soi-même ce problème, mais aussi d'assurer la souveraineté française dans ce domaine sur l'ensemble du territoire.
Tout s'accélère soudain. Il y a une sorte de passage de témoin entre Raphaël Alibert, garde des sceaux, et Marcel Peyrouton, ministre de l'intérieur, concernant l'élaboration du texte. Celui-ci prend la forme d'un statut "classique" comme il en existe ailleurs en Europe, avec une définition du juif en termes de race, qui s'inspire d'ailleurs de la définition allemande de 1935 des lois de Nuremberg, et toute une série d'interdictions professionnelles.
Béranger : Est-il exact que le gouvernement de Vichy a consulté préalablement le Vatican sur le premier statut des Juifs ?
Non. Ce qu'on sait, c'est que peut-être, le gouvernement - probablement par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères - aurait consulté dans le courant du mois d'août des représentants de l'Eglise catholique, puisqu'on sait qu'à la fin du mois d'août 1940, évêques et cardinaux, réunis en Assemblée, ont donné un "avis favorable" à l'idée d'une réglementation spécifique contre les juifs dans le cas où celle-ci serait adoptée par le gouvernement.
von paulus : Le maréchal Pétain ne s'est-il pas fait manœuvrer par Pierre Laval, vu son grand âge et sa probable sénilité ?
C'est ce qu'on dit les défenseurs du maréchal Pétain, la sénilité en moins, à la Libération. C'est la thèse du livre de Robert Aron, L''histoire de Vichy : le maréchal Pétain manoeuvré par Pierre Laval, mauvais génie de l'Etat français.
Cette thèse a depuis été totalement contredite par l'historiographie. On sait par exemple que pour ce premier statut des juifs, Pierre Laval ne joue pas un rôle moteur, au contraire du maréchal qui, au cours du fameux débat en Conseil des ministres du 1er octobre 1940, donne un avis très sévère sur les dispositions qui lui sont présentées.
Matthieu : Que penser de la très soudaine apparition de ce document ? Quel a pu être son parcours et quels sont les moyens de l'authentifier avec certitude ?
Il est certain que ce document est authentique. Nous avons différents témoignages sur le Conseil des ministres du 1er octobre 1940, et ce texte est très probablement la version qui a été soumise à ce Conseil.
L'enjeu est de savoir comment il a ressurgi. Cela reste un grand mystère. D'abord parce que dans aucune archive publique on ne trouve un seul document d'avant-projet du statut des juifs. Le seul document que l'on connaissait est la version finale, soumise aux Allemands le 2 octobre 1940, et qu'on retrouve dans les archives allemandes.
Mais dans les archives françaises, de l'Etat français, on n'a trouvé aucun document de cette nature. Donc, il ne peut venir que de la famille d'un des acteurs de l'élaboration de ce statut, qu'il soit ministre ou fonctionnaire.
On peut imaginer qu'il pourrait venir des papiers privés de Raphaël Alibert ou de Marcel Peyrouton, qui n'ont pas été versés aux archives publiques.
V : Les horreurs commises sous le régime de Vichy étaient-elles commanditées par l'Allemagne nazie ?
Il n'y a pas de demande allemande directe pour que Vichy adopte un statut des juifs.
D'ailleurs, les travaux de Christopher Browning ont montré que dans chacun des pays alliés ou défendant la politique nazie, les Allemands n'avaient pas eu besoin de demander expressément l'adoption de lois raciales.
On est dans un jeu d'influences indirectes : faisant le choix de collaborer Vichy se devait, comme tous les autres Etats fascistes ou autoritaires d'Europe - Italie, Roumanie, Hongrie ou Bulgarie -, d'avoir un statut des juifs.
jean-marie besset : D'où venait, selon vous, l'antisémitisme de Pétain? Prend-il ses sources dans l'affaire Dreyfus ?
L'antisémitisme de Pétain est un antisémitisme traditionnel. Mais pour l'affaire Dreyfus, par exemple, contrairement au général Weygand, on n'a aucun élément qui montrerait un quelconque antisémitisme de sa part.
De manière générale, avant 1940, le maréchal Pétain est considéré comme un militaire respectueux des institutions républicaines.
Mais ce que l'on voit bien dans ses rares interventions privées - puisque publiquement il ne s'est jamais exprimé pendant la guerre sur les juifs -, c'est qu'il défendait un antisémitisme traditionnel, considérant que les juifs n'étaient pas suffisamment assimilés à la nation française, n'étaient pas suffisamment des paysans, des artisans, etc.
C'est en règle générale une vision très primaire. Par exemple, lorsque Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui présente verbalement un projet de loi dépossédant les juifs de leurs biens, Pétain lui dit : "Ce n'est pas la peine de faire des lois compliquées, prenez-leur leurs biens."
JoeChip : Y a-t-il eu dans l'administration une résistance plus ou moins discrète aux directives antisémites ?
En ce qui concerne l'application du statut des juifs, c'est très variable. Marc-Olivier Baruch a par exemple montré que dans les ministères dits régaliens, on avait appliqué la loi de manière très rigoureuse, mais que dans certaines administrations dites plus techniques, on avait pu, ici ou là, protéger les employées juifs.
En ce qui concerne les déportations, on sait aussi qu'il y eut des fuites dans les services préfectoraux chargés d'organiser les rafles.
Cela reste malgré tout des phénomènes minoritaires.
Marc : En quoi ce document apporte-t-il un éclairage nouveau sur la politique de Vichy et de Pétain en particulier envers les juifs ?
Il n'apporte pas vraiment d'élément nouveau, il confirme deux choses. D'abord, on savait par le témoignage de Paul Baudouin, ministre des affaires étrangères, qui tenait son journal, qui a été publié, que le maréchal Pétain avait demandé à ce que les juifs soient éliminés de l'enseignement.
Si l'on émet l'hypothèse selon laquelle ce document est bien le fameux texte qui a été discuté durant deux heures lors du conseil des ministres du 1er octobre 1940, on peut voir sur quels termes le maréchal Pétain a réagi.
Ainsi, dans l'enseignement, le texte présenté ne concernait que les proviseurs, directeurs d'établissement, etc.
L'intervention de Pétain est donc décisive. On peut même penser qu'elle change entièrement la nature du statut des juifs, puisque avec les militaires, les enseignants, instituteurs, simples profs de collège ou de lycée, seront les principales victimes de l'application de ce texte.
Nicolas : Ce document peut-il être classé parmi les éléments d'histoire étudiés au collège ou au lycée ?
C'est malgré tout une version très, très proche de l'état final du statut des juifs. Ce document apporte-t-il plus que le statut des juifs qu'on étudie ? Je n'en suis pas sûr. Cela a à mon sens, avant tout, un intérêt pour les historiens qui étudient la genèse du statut des juifs. Mais même là, le document est tellement proche de l'état final que nous n'avons que quelques éclairages, dont le plus important est celui que je viens de mentionner sur les enseignants.
Nicolas Bernard : Pourquoi Vichy publie-t-il un tel texte en octobre alors que bien des lois liberticides de l'Etat français sont édictées et publiées dès l'été 1940 ?
C'est une très bonne question. Cela rejoint ce que je décrivais sur ce choix fait à un moment donné de temporiser, de ne pas faire de statut, alors qu'en juillet Raphaël Alibert bouillonnait d'en publier un. Ce nouveau calendrier est imposé par le fait qu'en septembre 1940 Vichy apprend que les Allemands préparent une ordonnance contre les juifs.
Se joue donc là une course de vitesse, à tel point que le statut des juifs a été paraphé le 3 octobre, le lendemain ou le surlendemain de la parution au Journal officiel allemand, en zone occupée, de cette fameuse ordonnance antisémite.
Guy : Quelle a été la position du Conseil d'Etat et son éventuelle contribution à la rédaction du projet ?
Il n'est pas consulté. En revanche, il va l'être à propos des demandes de dérogation à titre exceptionnel. Et on sait que le Conseil d'Etat, dans ses avis, s'est montré très sévère, y compris concernant des personnalités comme Robert Debré ou Jacques Rueff.
Bob : Des autorités politiques ou religieuses ou politiques ont-elles réagi contre un tel statut à l'époque ?
En ce qui concerne les politiques, il n'y a plus de débat démocratique en France, donc il n'y a pas de réaction, si ce n'est celles émanant de hautes personnalités d'origine juive comme Pierre Masse.
Du côté des autorités religieuses, on sait que le pasteur Boegner, chef de l'Eglise protestante, a montré sa désapprobation très rapidement.
Ce n'est pas le cas des représentants de l'Eglise catholique. D'où d'ailleurs la célèbre repentance de 1997 qui concernait directement son attitude vis-à-vis du premier statut des juifs d'octobre 1940.
Repère
Laurent Joly est l'auteur d'une biographie de Xavier Vallat publiée chez Grasset, en 2001. Il a aussi consacré un ouvrage à Vichy dans la "Solution finale" (Grasset, 2006). Il publiera
prochainement un livre sur l'antisémitisme de bureau, toujours chez le même éditeur.
Chat modéré par Chat modéré par Olivier Biffaud et Thomas Wieder
Pétain et les juifs : "La question est de savoir d'où vient ce document"
pour Le Monde.fr | 04.10.10 | 18h44 • Mis à jour le 04.10.10 | 19h05
Pierre : Qui étaient les personnes (leurs fonctions) qui ont rédigé le texte soumis à Pétain ?
Laurent Joly : Très longtemps, dès la Libération, on accuse Raphaël Alibert, ministre de la justice, proche du maréchal Pétain, d'être l'unique auteur du statut.
En réalité, il semble que ce texte, ce soit le ministre de l'intérieur, Marcel Peyrouton, qui l'ait rapporté en conseil des ministres, et ce texte a donc été probablement préparé par ses collaborateurs.
L'élaboration du texte final est une oeuvre gouvernementale. On sait que le maréchal Pétain est intervenu, au moins sur la question des enseignants et des magistrats.
Un passant : Pourriez-vous revenir sur les circonstances de l'adoption du statut des juifs ?
D'abord, l'idée d'un statut des juifs est tout de suite présente dans le Vichy de juillet 1940.
Par exemple, Raphaël Alibert, qui est nommé garde des sceaux dans le premier gouvernement de juillet 1940, se vante de préparer un statut qu'il définit "aux petits oignons".
Et de tout horizon, on s'attend à ce que Vichy adopte une loi, un statut qui serait spécifique pour les juifs. Or, ce n'est pas cette solution que le gouvernement choisit au départ.
Il préfère sans doute - et sur ce point Pierre Laval, vice-président du Conseil, calcule qu'une loi raciale passerait mal dans l'opinion - le détour de mesures générales qui visent les naturalisés, les "Français de fraîche date".
Pour résumer, les Français nés de père étranger peuvent être licenciés de leurs emplois dans la fonction publique, et surtout, dans deux professions, qui n'ont pas été choisies au hasard : le barreau et la médecine, lesquelles, selon la propagande antisémite, étaient envahies par les juifs depuis l'entre-deux-guerres.
D'autre part, en juillet 1940, Vichy a adopté une loi de révision des naturalisations, dont - Patrick Veil l'a démontré - l'application visera principalement les juifs. Dans les décombres, Lucien Rebatet, fasciste et antisémite acharné, se félicite d'ailleurs de ces lois qui règlent le problème juif sans avoir l'air d'y toucher.
Tout bascule en septembre 1940. Le 10 septembre, le gouvernement apprend que les autorités allemandes préparent une ordonnance générale sur les juifs.
L'idée d'un statut revient donc au premier plan, car dans l'esprit de Vichy, il s'agit à la fois de montrer aux Allemands que l'on peut régler soi-même ce problème, mais aussi d'assurer la souveraineté française dans ce domaine sur l'ensemble du territoire.
Tout s'accélère soudain. Il y a une sorte de passage de témoin entre Raphaël Alibert, garde des sceaux, et Marcel Peyrouton, ministre de l'intérieur, concernant l'élaboration du texte. Celui-ci prend la forme d'un statut "classique" comme il en existe ailleurs en Europe, avec une définition du juif en termes de race, qui s'inspire d'ailleurs de la définition allemande de 1935 des lois de Nuremberg, et toute une série d'interdictions professionnelles.
Béranger : Est-il exact que le gouvernement de Vichy a consulté préalablement le Vatican sur le premier statut des Juifs ?
Non. Ce qu'on sait, c'est que peut-être, le gouvernement - probablement par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères - aurait consulté dans le courant du mois d'août des représentants de l'Eglise catholique, puisqu'on sait qu'à la fin du mois d'août 1940, évêques et cardinaux, réunis en Assemblée, ont donné un "avis favorable" à l'idée d'une réglementation spécifique contre les juifs dans le cas où celle-ci serait adoptée par le gouvernement.
von paulus : Le maréchal Pétain ne s'est-il pas fait manœuvrer par Pierre Laval, vu son grand âge et sa probable sénilité ?
C'est ce qu'on dit les défenseurs du maréchal Pétain, la sénilité en moins, à la Libération. C'est la thèse du livre de Robert Aron, L''histoire de Vichy : le maréchal Pétain manoeuvré par Pierre Laval, mauvais génie de l'Etat français.
Cette thèse a depuis été totalement contredite par l'historiographie. On sait par exemple que pour ce premier statut des juifs, Pierre Laval ne joue pas un rôle moteur, au contraire du maréchal qui, au cours du fameux débat en Conseil des ministres du 1er octobre 1940, donne un avis très sévère sur les dispositions qui lui sont présentées.
Matthieu : Que penser de la très soudaine apparition de ce document ? Quel a pu être son parcours et quels sont les moyens de l'authentifier avec certitude ?
Il est certain que ce document est authentique. Nous avons différents témoignages sur le Conseil des ministres du 1er octobre 1940, et ce texte est très probablement la version qui a été soumise à ce Conseil.
L'enjeu est de savoir comment il a ressurgi. Cela reste un grand mystère. D'abord parce que dans aucune archive publique on ne trouve un seul document d'avant-projet du statut des juifs. Le seul document que l'on connaissait est la version finale, soumise aux Allemands le 2 octobre 1940, et qu'on retrouve dans les archives allemandes.
Mais dans les archives françaises, de l'Etat français, on n'a trouvé aucun document de cette nature. Donc, il ne peut venir que de la famille d'un des acteurs de l'élaboration de ce statut, qu'il soit ministre ou fonctionnaire.
On peut imaginer qu'il pourrait venir des papiers privés de Raphaël Alibert ou de Marcel Peyrouton, qui n'ont pas été versés aux archives publiques.
V : Les horreurs commises sous le régime de Vichy étaient-elles commanditées par l'Allemagne nazie ?
Il n'y a pas de demande allemande directe pour que Vichy adopte un statut des juifs.
D'ailleurs, les travaux de Christopher Browning ont montré que dans chacun des pays alliés ou défendant la politique nazie, les Allemands n'avaient pas eu besoin de demander expressément l'adoption de lois raciales.
On est dans un jeu d'influences indirectes : faisant le choix de collaborer Vichy se devait, comme tous les autres Etats fascistes ou autoritaires d'Europe - Italie, Roumanie, Hongrie ou Bulgarie -, d'avoir un statut des juifs.
jean-marie besset : D'où venait, selon vous, l'antisémitisme de Pétain? Prend-il ses sources dans l'affaire Dreyfus ?
L'antisémitisme de Pétain est un antisémitisme traditionnel. Mais pour l'affaire Dreyfus, par exemple, contrairement au général Weygand, on n'a aucun élément qui montrerait un quelconque antisémitisme de sa part.
De manière générale, avant 1940, le maréchal Pétain est considéré comme un militaire respectueux des institutions républicaines.
Mais ce que l'on voit bien dans ses rares interventions privées - puisque publiquement il ne s'est jamais exprimé pendant la guerre sur les juifs -, c'est qu'il défendait un antisémitisme traditionnel, considérant que les juifs n'étaient pas suffisamment assimilés à la nation française, n'étaient pas suffisamment des paysans, des artisans, etc.
C'est en règle générale une vision très primaire. Par exemple, lorsque Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, lui présente verbalement un projet de loi dépossédant les juifs de leurs biens, Pétain lui dit : "Ce n'est pas la peine de faire des lois compliquées, prenez-leur leurs biens."
JoeChip : Y a-t-il eu dans l'administration une résistance plus ou moins discrète aux directives antisémites ?
En ce qui concerne l'application du statut des juifs, c'est très variable. Marc-Olivier Baruch a par exemple montré que dans les ministères dits régaliens, on avait appliqué la loi de manière très rigoureuse, mais que dans certaines administrations dites plus techniques, on avait pu, ici ou là, protéger les employées juifs.
En ce qui concerne les déportations, on sait aussi qu'il y eut des fuites dans les services préfectoraux chargés d'organiser les rafles.
Cela reste malgré tout des phénomènes minoritaires.
Marc : En quoi ce document apporte-t-il un éclairage nouveau sur la politique de Vichy et de Pétain en particulier envers les juifs ?
Il n'apporte pas vraiment d'élément nouveau, il confirme deux choses. D'abord, on savait par le témoignage de Paul Baudouin, ministre des affaires étrangères, qui tenait son journal, qui a été publié, que le maréchal Pétain avait demandé à ce que les juifs soient éliminés de l'enseignement.
Si l'on émet l'hypothèse selon laquelle ce document est bien le fameux texte qui a été discuté durant deux heures lors du conseil des ministres du 1er octobre 1940, on peut voir sur quels termes le maréchal Pétain a réagi.
Ainsi, dans l'enseignement, le texte présenté ne concernait que les proviseurs, directeurs d'établissement, etc.
L'intervention de Pétain est donc décisive. On peut même penser qu'elle change entièrement la nature du statut des juifs, puisque avec les militaires, les enseignants, instituteurs, simples profs de collège ou de lycée, seront les principales victimes de l'application de ce texte.
Nicolas : Ce document peut-il être classé parmi les éléments d'histoire étudiés au collège ou au lycée ?
C'est malgré tout une version très, très proche de l'état final du statut des juifs. Ce document apporte-t-il plus que le statut des juifs qu'on étudie ? Je n'en suis pas sûr. Cela a à mon sens, avant tout, un intérêt pour les historiens qui étudient la genèse du statut des juifs. Mais même là, le document est tellement proche de l'état final que nous n'avons que quelques éclairages, dont le plus important est celui que je viens de mentionner sur les enseignants.
Nicolas Bernard : Pourquoi Vichy publie-t-il un tel texte en octobre alors que bien des lois liberticides de l'Etat français sont édictées et publiées dès l'été 1940 ?
C'est une très bonne question. Cela rejoint ce que je décrivais sur ce choix fait à un moment donné de temporiser, de ne pas faire de statut, alors qu'en juillet Raphaël Alibert bouillonnait d'en publier un. Ce nouveau calendrier est imposé par le fait qu'en septembre 1940 Vichy apprend que les Allemands préparent une ordonnance contre les juifs.
Se joue donc là une course de vitesse, à tel point que le statut des juifs a été paraphé le 3 octobre, le lendemain ou le surlendemain de la parution au Journal officiel allemand, en zone occupée, de cette fameuse ordonnance antisémite.
Guy : Quelle a été la position du Conseil d'Etat et son éventuelle contribution à la rédaction du projet ?
Il n'est pas consulté. En revanche, il va l'être à propos des demandes de dérogation à titre exceptionnel. Et on sait que le Conseil d'Etat, dans ses avis, s'est montré très sévère, y compris concernant des personnalités comme Robert Debré ou Jacques Rueff.
Bob : Des autorités politiques ou religieuses ou politiques ont-elles réagi contre un tel statut à l'époque ?
En ce qui concerne les politiques, il n'y a plus de débat démocratique en France, donc il n'y a pas de réaction, si ce n'est celles émanant de hautes personnalités d'origine juive comme Pierre Masse.
Du côté des autorités religieuses, on sait que le pasteur Boegner, chef de l'Eglise protestante, a montré sa désapprobation très rapidement.
Ce n'est pas le cas des représentants de l'Eglise catholique. D'où d'ailleurs la célèbre repentance de 1997 qui concernait directement son attitude vis-à-vis du premier statut des juifs d'octobre 1940.





 Point de
vue
Point de
vue "L'équipe de France n'est qu'un reflet" des différentes vagues d'immigration
"L'équipe de France n'est qu'un reflet" des différentes vagues d'immigration « L’encre des programmes de seconde à peine sèche, les experts de la rue de Grenelle viennent de rédiger, en quelques semaines, les projets de programmes de 1ère. En
Histoire, il vaudrait mieux parler d’une exécution sommaire.
« L’encre des programmes de seconde à peine sèche, les experts de la rue de Grenelle viennent de rédiger, en quelques semaines, les projets de programmes de 1ère. En
Histoire, il vaudrait mieux parler d’une exécution sommaire. Cinéma : Robin des Bois de Ridley Scott
Cinéma : Robin des Bois de Ridley Scott guerre est finie, l’Amérique a retrouvé ses racines européano-folkloriques.
guerre est finie, l’Amérique a retrouvé ses racines européano-folkloriques.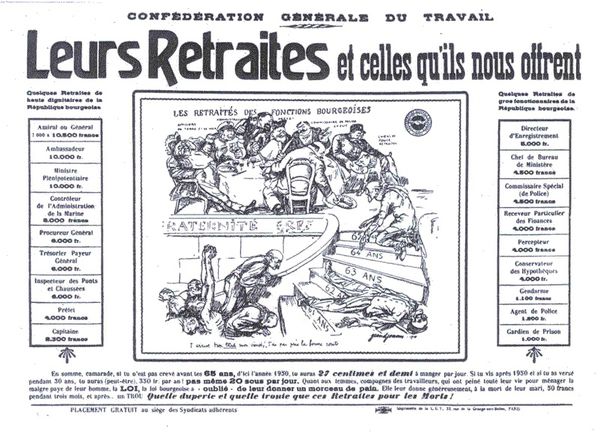
 Quelques principes de vigilance à propos de la place faite à l’histoire-géographie et aux sciences sociales en général dans les lycées qui se prépare.
Quelques principes de vigilance à propos de la place faite à l’histoire-géographie et aux sciences sociales en général dans les lycées qui se prépare.